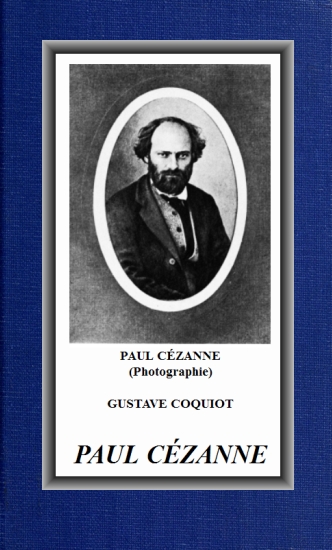
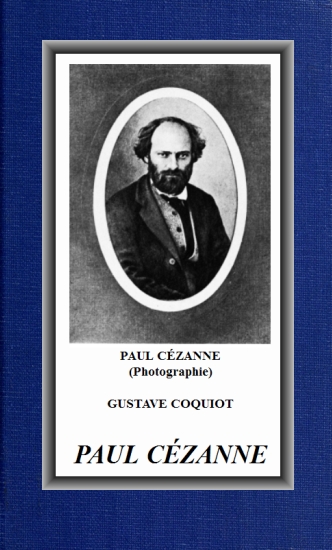
TABLE DES CHAPITRES
TABLE DES ILLUSTRATIONS HORS-TEXTE
| DU MÊME AUTEUR |
|---|
| — |
| Les Féeries de Paris (Couverture de R. Carabin). |
| Les Soupeuses (Dessins de George Bottini). |
| Le vrai J.-K. Huysmans (Portrait de J.-F. Raffaelli). |
| Poupées de Paris. (Avec des illustrations). |
| Henri de Toulouse-Lautrec (Avec des illustration). |
| Le vrai Rodin (Avec des illustrations). |
| Paris, voici Paris! (Couverture de Sacchetti). |
| Cubistes, Futuristes, Passéistes (Avec des illustrations). |
| Rodin (Bernheim-Jeune, éditeurs) (Avec des illustrations). |
| Rodin à l’Hôtel Biron et à Meudon (Avec des illustrations). |
| THÉATRE |
| (Seul ou en Collaboration) |
| M. Prieux est dans la salle. |
| Deux heures du matin... quartier Marbeuf (Couverture de Géo Dupuis). |
| Hôtel de l’Ouest... Chambre 22. |
| Une nuit de Grenelle (Couverture de Géo Dupuis) |
| Sainte-Roulette. |
| EN PRÉPARATION: |
| Les Pantins de Paris (Avec des dessins inédits de J.-L. Forain). |
| Pierre Bonnard. |
GUSTAVE COQUIOT

PARIS
Société d’Éditions Littéraires et Artistiques
LIBRAIRIE PAUL OLLENDORFF
50, CHAUSSÉE D’ANTIN, 50
—
Tous droits réservés.
IL A ÉTÉ TIRÉ A PART:
Dix exemplaires sur papier de Chine
Numérotés à la presse
Ceci n’est point un LIVRE consacré à Cézanne et à son œuvre. Ce sont de simples notes à ajouter à celles qui ont été publiées déjà. Le livre à écrire est toujours celui que l’on n’écrit pas. Il sera possible de l’écrire quand on ne sera plus étranglé par des considérations de famille et quand on pourra étriller ses contemporains. Que la lâcheté et l’hypocrisie soient définitivement vomies, et désormais tous les livres seront intéressants! Ces présentes notes sont surtout destinées à celui qui, dans cent ans, composera, en toute liberté, le copieux livre que la postérité doit à Cézanne.
G. C.
J’ajoute que ces notes devaient être publiées au mois d’octobre 1914. Je les ai revues, et les voici publiées en cette année 1919.
G. C.

LOUIS-AUGUSTE CÉZANNE
Père du peintre Paul Cézanne
(Photographie)
Fin de Juillet 1914. Marseille. Dans toute la Cannebière, un brouhaha de cris. Le soleil embrase le vieux Port;—les bateaux, alourdis, pèsent de toute leur carêne. L’eau est pourrie et pue. Les cafés regorgent. On attise la flamme patriotique à grandes rasades de vermouth et de bitter. Les tramways secouent leur ferraille. Une foule. C’est certain, le Midi, cette fois, bouge! Aura-t-on la guerre? Ne l’aura-t-on pas?
On s’arrache les journaux. Ils bêtifient, ne savent rien. Passent déjà des gens qui hurlent: à Berlin! à Berlin! Il y a une course de taureaux fixée au 2 août. Elle se fera; et, tout de suite après, s’il le faut, on partira pour la frontière. La flamme patriotique flambe maintenant. On acclame des soldats qui, l’air morne, descendent la rue de Noailles.
Marseille! c’est à dire des Turcs, des Gênois, des Grecs, des Italiens, des Levantins, des tenanciers de bars et de water-closets; une fleur de la France!
Je suis pris là par les tragiques négociations. Et je vois bien que les Prussiens, s’ils bougent, trouveront ici de farouches adversaires; car déjà des cortèges se forment, tapagent, musique en tête et drapeaux déployés.
Deux Août! La corrida n’aura pas lieu! C’est la guerre! Les Italiens ont pris les devants; et, lampions au bout des perches, ils défilent. Mâles accents et chants alternés. On a l’impression que tout le Midi se lève, va parcourir d’une traite les interminables kilomètres qui le séparent de la frontière agressive.
Je suis ici, venu pour me documenter sur Cézanne, à Aix. Je rencontre bientôt des Parisiens notoires que la retraite de Charleroi a inquiétés. Ils s’efforcent de sourire; ils disent qu’ils ont confiance; mais, n’est-ce pas? quelques précautions s’imposent. Moi, puisque je ne suis pas mobilisable, je resterai à Marseille; et, de temps en temps, j’irai à Aix. Tout le monde, du reste, croit que la guerre ne durera pas longtemps; aussi, nous attendons, confiants.
Un jour, quelqu’un m’a dit: «Si vous voulez aller à Aix-en-Provence, ne prenez pas le train, mais prenez le tramway!» Alors j’ai suivi ce conseil.
Dans le Midi, on le sait, tout est sale, tout va de travers, aussi tout est pittoresque. Ainsi, il y a certainement un tramway pour aller de Marseille à Aix; mais le tramway, il le faut prendre d’assaut si l’on veut y quérir une place. Les employés, regardent, indifférents; ou «ils font la conversation». Enfin, l’on se case—et, après d’interminables discussions entre voyageurs et employés, l’on part.
L’on est moins sûr d’arriver. Car même, dès ce début de guerre, ce brinqueballant tramway—électrique—a des pannes. Cela lui arrive d’une façon tout à fait fantaisiste, au bas d’une montée ou au plein milieu d’une descente. Et il n’y a qu’à attendre le bon vouloir d’on ne sait quoi! Mais si le voyage s’accomplit, de bout en bout, quelle route amusante, dès qu’on a débouché d’une interminable grande rue marseillaise, et de ces faubourgs qui suintent la crasse et l’ordure, fourmillant de bars, de boutiques de coiffeurs et d’épiceries rances.
Voici ce microcosme:
Moissons coupées; routes et maisons poussiéreuses; pins et oliviers; maisons avec persiennes peintes vert-véronèse; roches grises et rouges; quelques vignes rares; collines rocheuses avec arbrisseaux; acacias, mimosas; routes très blanches et toits de tuiles grillées;—sous un ciel bleu uniforme pas très intense, doux, un peu dégradé en rose pâli sur l’horizon. Platanes dans les villages; bars toujours.
Et ces noms de stations, charmants: Saint-Antoine, Septèmes, les Peyrets, le Pin, la Malle, Violési-Cabriès, Bouc-bel-Air, la Mounine, Trois Pigeons, Leynes, Frères-gris, Pont de l’Arc.
Et comme ça on arrive à Aix! Avec grandes sonnailles l’inconfortable tramway roule enfin sur le cours Mirabeau, à six rangées de platanes, que les Aixois appellent simplement le Courss. Et il roule comme ça jusqu’à la statue du roi René, épouvantante et morne, comme une borne.
Me voici à Aix. Je pense fortement à la guerre et non moins fortement à Cézanne. Je suis venu ici exprès pour lui, ou du moins pour interroger ceux qui l’ont connu; et j’ai envie de crier mon désir à tout venant.
Premier point: Je vais acheter un plan de la ville d’Aix. J’entre donc chez un libraire qui me dévisage et me répond, sans courtoisie, qu’il n’en a point. Soit! Je verrai à en trouver un plus tard; et j’avise sur le Courss un cocher; car j’ai mon idée de me faire conduire tout de suite chez Mme Brémond, la dame de compagnie qui passa dix années aux côtés de Cézanne. Mais le cocher, pourtant Aixois, ne connait pas plus que moi l’adresse de Mme Brémond. Alors, en calèche découverte, me voilà roulant à travers les rues d’Aix, demandant à tous les échos le nom et l’adresse de Mme Brémond. Premières courses vaines; je me décide alors à aller déjeuner.
A ce moment, une foule de jeunes et vieux Aixois, de femmes, de filles, de chiens et autres aimables spécimens de ce pays veut bien me poursuivre de ses huées et de ses cris. En tête de ce cortège, marchent un brigadier de gendarmerie et un gendarme. Et, à peine suis-je installé à une table, à une terrasse de restaurant, que l’aimable foule redouble ses cris, tandis que le brigadier s’avance et réclame mes papiers. Je les lui présente. Il en prend connaissance, et, d’une voix nette, le voici qu’il crie à la foule: «Citoyens, monsieur est un Français comme nous; c’est un frère!» Des bravos éclatent; et, avec regret, la très précautionneuse foule se décide enfin à me f... la paix!
«Un espion! J’ai été pris pour un espion»! O patrie de Cézanne, combien j’ai admiré depuis cette minute ta vigilance patriotique aux premiers jours de la guerre; toi qui, à des centaines, des centaines de kilomètres des Prussiens, passais pour refroidie, indifférente à l’invasion! O braves Aixois, quel poète chantera pour vous un los aux pieds de votre montagne sacrée, la Sainte Victoire, où Marius rossa les Teutons! Vous voyez, poilus du Nord, le Midi bougeait, et depuis, vous le savez, il a largement bougé, pendant toute la grande guerre! Ah! les braves gens!
Et je pensais, moi: Ainsi Cézanne, le grand Cézanne, notre grand Cézanne est né parmi ces attentives sentinelles de l’extrême-arrière. Alors, avant que de parler de lui, de ne parler que de lui, voyons donc comment se présente cette héroïque ville d’Aix-en-Provence.
Vieux hôtels déchus, amas de rues commerçantes. Ville écrasée sous sa magnificence ancienne, véritable splendeur vraiment alors entre le bagne de Toulon et les mercantis marseillais. Aujourd’hui, seulement de la noblesse épuisée et du négoce restreint.
Que font alors ici encore archevêché, une Cour d’Appel, des Facultés de Droit et des Lettres, des écoles des Beaux-Arts, un Musée enfin qui l’emporte il est vrai mille fois sur celui de Marseille, si indigent que tout dégoût s’affirme?
Oui, Aix, ville morne, ville morte. Rues silencieuses où vivent, où s’ankylosent de très vieux fossiles; où des forbans ont élu domicile dans de beaux hôtels chenus, et souillent de leur présence les larges escaliers de pierre que montait et redescendait avec tant d’aisance, le Mignon duc de Villars, gouverneur de Provence, à la lèvre fleurie et au derrière complaisant.
Aix, ville désuète, figée, maintenant hors d’âge. Sur ton Courss, le côté gauche, en regardant la statue du roi René, c’était autrefois la roture qui se le réservait, n’empiétant pas sur le côté droit, le côté de la noblesse, le côté des hôtels aujourd’hui rongés, vidés par les créanciers, le côté des fausses merveilles, le côté des cariatides de l’hôtel d’Espagnet, par exemple, hideuses sculptures d’un cloutier, et qu’un haut fonctionnaire des Beaux-Arts spécialement choisi et honoré par notre République, feu Larroumet, attribua simplement à Puget!
Aix, enfin, vieux visage qui n’a plus rien à nous dire. Ville antiquaille, ville aux nobles rampes de fer, aux balcons suintants, aux vastes salles que ne traversent plus que les galops des rats, quand la ville est endormie dans sa béatitude bigote et voluptueusement égoïste.
Mais voici qui est mieux: Aix, ville benoîte, sommeillante, c’est sur ton Courss, côté de la roture, qu’allait, pour nous donner un jour le peintre Paul Cézanne, venir, en l’année 1825, s’installer, comme marchand chapelier, Louis-Auguste Cézanne, né vers 1797, au village de Zacharie (Var).
*
* *
Rappelons que la chapellerie—en poils de lapins—était alors la grande industrie d’Aix-en-Provence. Voulant aller vite, Louis-Auguste Cézanne s’associa tout de suite avec les sieurs Martin et Coupin, chapeliers. Alors les plaisantins de dire: «Martin, Coupin et Cézanne (seize ânes) font dix huit bêtes!» Dire absurde, car les trois associés, aussi malins l’un que l’autre durent bientôt se séparer; et le père Cézanne alla se réinstaller, c’était vers 1848, toujours sur le Courss, mais cette fois au coin de l’ancienne rue des Grands-Carmes, qu’on appelle maintenant rue Fabrot.
Si vous voulez des renseignements sur le père Cézanne, attendez-vous à des choses contradictoires. Pour les uns, le père Cézanne fut une sorte de père Grandet, autoritaire, bien avisé et avare. Et l’on vous entasse pour ce dire je ne sais combien de faits justificatifs. Pour les autres, le père Cézanne fut, au contraire, un exemple humain de la plus rare espèce. En tout cas, un Aixois, qui m’a accablé de plus de renseignements que je n’en saurais raconter, veut bien se souvenir vers les années 1878-1880, d’un beau vieillard, avec ce signalement physique: taille au-dessus de la moyenne, profil fin, figure entièrement rasée, yeux vifs, rusés, regard profond, front chauve et cheveux blancs. Confrontez donc avec le portrait ici reproduit. Quant à sa mise, elle était simple et modeste. Singularité principale: des souliers en cuir blanc (on nomme ainsi, en Provence, les chaussures que portent les gens de la campagne); et, cela, afin d’économiser le cirage! Mais, toutefois, sortait-il pour ses affaires ou voyageait-il, alors il chaussait des souliers noirs et bien cirés, complétés par un «haut-de-forme». En temps ordinaire, cependant sa casquette lui suffisait; sa casquette, vraiment, car c’était lui-même qui l’avait coupée et parée d’une visière fort longue. On disait à ce propos, à Aix: «As vi lou liché daou pero Cézanne?» As-tu vu le louchet du père Cézanne? Et lui, madré, retors, très prudent, il laissait dire, racontant seulement volontiers que, dernier survivant de nombreux frères et sœurs, c’était lui, Cézanne le pichot (ou petit), qui assumait la chance enfin venue de toute sa famille.
Il aimait l’argent, c’était là un fait positif. Aussi, après s’être séparé de ses associés Martin et Coupin, avait-il eu l’idée de placer son argent chez ses clients. Cela bientôt lui avait donné le goût de la banque. Précisément, la Banque Bargès, la seule qui existât alors à Aix, rue Ancienne-Madeleine, venait de tomber en faillite. Et dans cette banque le père Cézanne avait vite reconnu en la personne du caissier, le sieur Cabassol, un gaillard rusé et madré que Bargès,—d’où sa déconfiture, n’avait jamais voulu écouter. Aussi, sans plus chercher d’histoires, le père Cézanne proposa tout de suite à Cabassol de s’associer avec lui et de fonder une banque au capital de 100.000 francs. Aussitôt dit, aussitôt fait; et les deux associés s’installèrent rue Boulegon, dans un immeuble qui appartenait à la famille Cabassol.
Les deux compères s’entendirent à merveille; et l’on s’amuse encore à Aix des deux vieux finauds, Cézanne et Cabassol, qui, toujours l’un s’appuyant sur l’autre, menèrent la banque tant et si bien que lorsqu’ils se séparèrent en 1870, ils avaient tous les deux fait fortune. Et sans nul risque jamais, d’ailleurs; car un emprunteur douteux se présentait-il; en sa présence, le père Cézanne disait à son associé: «Qué n’en pensa Cabassoou?» Et cela signifiait «Refusons le prêt!» Le père Cézanne connaissait heureusement à un sou près la situation de tout Aix et environs.
Il s’était décidé, le 29 janvier 1844, à épouser une de ses ouvrières, Anne-Elisabeth-Honorine Aubert, née à Aix. Il légitimait ainsi les naissances de ses deux premiers enfants: Paul Cézanne, le peintre, né le 19 janvier 1839; et Marie Cézanne, née en l’année 1841; tous deux nés passage Agard, un passage étroit sis à côté de sa boutique. Sa seconde fille, Rose Cézanne, naquit en 1845.

LE JAS DE BOUFFAN (Façade sur le jardin)
PHOTO DE L’AUTEUR
En l’année 1859, il se découvrit un beau jour des goûts champêtres. Un domaine situé à deux kilomètres environ d’Aix, sur la route de Galice, qui va au château de Galice, était précisément à vendre: c’était le Jas de Bouffan (un jas, c’est l’endroit où l’on mène paître les troupeaux, et buffa désigne le vent qui souffle avec violence). M. de Joursin, le propriétaire, vendit au père Cézanne ce domaine pour la somme de 80.000 francs. Il y avait une grande bâtisse carrée (construction du XVIIe) à usage d’habitation, de vastes terrains (15 hectares clos de murs) et une ferme attenante.
Le père Cézanne avait acheté ce domaine pour se reposer le dimanche, comme un bourgeois dans toute province a sa vigne ou son clos.
Plus loin, je reparlerai de ce Jas de Bouffan, qui devait rester entre les mains du père Cézanne un trop grand domaine inutilisé; et acheté surtout, disent les Aixois, par ostentation.
Et j’arrive à Paul Cézanne, peintre.
*
* *
Comment, dès l’âge de raison, va-t-il s’accorder avec Aix et les Aixois?
Comment aussi va-t-il s’accorder avec son père et avec sa mère?
Comme le père Cézanne est riche, l’enfant est placé naturellement au collège de la ville, le collège Bourbon, devenu aujourd’hui le lycée Mignet. Ainsi qu’en toutes les villes, mêmes laides et sempiternelles bâtisses, grandes cours vides, nues. Avant tout, il faut attrister les enfants. Cela se produisit non moins naturellement pour Paul Cézanne, qui rencontra là ses premiers amis: Fortuné Marion, qui deviendra professeur à la Faculté des sciences de Marseille, archéologue et géologue et dont Cézanne fera le portrait en 1865; Collot, qui fut professeur à la Faculté des Sciences de Dijon; Numa Coste, publiciste; Baille, qui deviendra un «Bourgeois»; et enfin avec quelques autres, Emile Zola dont la mère est grecque, et dont le père, un gênois, est chargé de construire près d’Aix le barrage qui portera son nom.
Ces premières années de collège n’apportent que les seules joies des courses à travers champs, sur la route du Tholonet, aux Pinchinats, à la Sainte-Baume, à Saint-Antonin ou à Puy-Ricard.
Le 12 Novembre 1858, Paul Cézanne est reçu bachelier ès lettres, avec la mention assez bien. Il prend ensuite huit inscriptions en 1858-59 et 1859-60; et, le 29 novembre 1859, il passe le premier examen de bachelier en droit. Il est reçu.
Entre temps il a appris la musique au collège Bourbon, en compagnie de Zola et d’un camarade nommé Marguery, qui deviendra avoué à la Cour d’appel d’Aix. Leur professeur de musique fut Henry Poncet, ancien maître de chapelle de la métropole d’Aix (Saint-Sauveur), et père du Directeur actuel du Conservatoire: M. Joseph Poncet. Maintenant, par le recul, on ne voit pas très bien, je l’avoue, le grave Paul Cézanne jouant du piston! mais il est néanmoins acquis que Marguery, Zola et lui, Paul Cézanne, firent partie de la musique des Amateurs, qui avait la gloire de jouer aux processions et aux fêtes: Marguery, 1er piston; Paul Cézanne, 2e piston; et Emile Zola, clarinette.
Mieux encore, s’imagine-t-on Paul Cézanne dévoré de passion cynégétique? Cependant, une année, tandis qu’il préparait son droit, il prit un permis de chasse; et, sans s’estropier, heureusement, il partit de l’avant, essayant de tuer des petits oiseaux: alouettes, culs blancs, etc. Zola et un ami commun, Jacques Boyer, décédé notaire à Eyguières, chassèrent même un jour avec lui dans les plaines de Puy-Ricard; mais ils blaguèrent tout le temps Cézanne sur sa maladresse. «Tu es incapable de rien tuer, lui disaient-ils, tu manques tous les coups!»—On va bien voir!» répond Cézanne; et il jette son chapeau en l’air, épaule et va tirer; quand Zola le devance, et placé immédiatement sous le chapeau, le crible de petits plombs. Le chapeau retombe, mitraillé. Furieux, Cézanne s’empare alors de ce qui avait été son couvre-chef; et il se sauve à grandes enjambées. De ce jour-là, il fut dégoûté de la chasse; moins tenace que Tartarin, à qui Daudet prête une aventure de chasse à la casquette, sans avoir peut-être connu l’aventure arrivée à Cézanne.
Au fond, Paul Cézanne s’ennuyait malgré chasse et musique. Il faisait son droit, sans passion. Son père ambitionnait naturellement pour son fils une situation considérable, justement honorée par de séculaires hommages. Une charge de notaire ou d’avoué, par exemple. A Aix, on n’avait d’yeux que pour ces hauts magistrats des affaires. Paul Cézanne se laissait tirailler par son père, qui voulait imposer une situation, et par Zola qui, hanté déjà de gloire littéraire, ne pensait qu’à Paris. Mme Cézanne, la mère, n’avait pas une décisive autorité pour soutenir son fils; néanmoins elle put obtenir déjà que Paul entrerait à l’école du Musée d’Aix, pour y dessiner, puisqu’il le voulait; et, que maintenant, c’était là la seule chose qui pût l’intéresser.
Le premier professeur de Cézanne à cette école fut Joseph Gibert, mort en 1891. Il enseignait le modelage et le dessin d’après le modèle vivant. Un nommé Meissonier y posait souvent. Je possède une académie estompée par Paul Cézanne d’après ce modèle.
Mais un jour vint que Zola, installé enfin à Paris, réclama par d’enthousiastes lettres la venue de son ami Cézanne. On imagine quel accueil réserva le père Cézanne à ce désir de rejoindre Zola à Paris. Le désaccord éclata complet entre le père Cézanne et son fils qui ne demandait rien moins qu’à «mal tourner». Au reste, c’était plus simple: le père Cézanne n’entendait rien au dessin, à la peinture; et il exigeait que son fils fît ce qu’il ordonnait, c’est-à-dire qu’il se créât une situation honorée et rémunératrice. C’était bien le moins que l’argent gagné dans la chapellerie et dans la banque attirât sur lui, par son fils, d’estimables hommages.
Mais Aix, mais la situation future ne pouvaient plus retenir Cézanne.
Il détestait déjà ses compatriotes uniquement préoccupés de négoces et d’affaires. Il brûlait d’une révolte instinctive contre ces commerçants que le voisinage de Marseille gavait d’une ardeur excessive; ces commerçants dont pas un à coup sûr n’avait visité le Musée, où tout de même quelques toiles rehaussaient de beauté le lieu. Oui, aucun de ces trafiquants ne connaissait la Chaste Suzanne, de Rubens; la Vierge au donateur, du Maître de Flémalle; les Soldats jouant aux cartes, des frères Le Nain;—ou encore le portrait du duc de Villars, par La Tour?... En vérité, ces gens-là ignoraient tout; et il n’y avait qu’à les voir au café, bruyants et satisfaits pour deviner quels épais inconscients étaient tous ces négociants Aixois. Aix, enfin! Aix n’avait plus rien à lui dire; il connaissait par cœur les seules choses louables: l’Hôtel de Ville, dont l’architecture sans réel imprévu plaît; la Halle aux grains; le cloître de la cathédrale Saint-Sauveur; et quelques autres aspects encore dont il eût pu, certes, dessiner de mémoire les seuls accents à retenir. Les rues, également, les rues étaient pour lui des couloirs de cage où il promenait son désœuvrement, sa misanthropie commençante, son éloignement bourru des autres hommes, lui qui ne pouvait se satisfaire des plaisirs faciles des étudiants ses camarades, plutôt ses ennemis. Oui, entre lui et Aix et les Aixois le désaccord s’établissait complet, comme il l’était entre lui et son père, le banquier Cézanne, têtu, obstiné, ne pouvant point comprendre que le fils d’un homme riche comme il l’était, s’obstinât à vouloir pendant toute sa vie dessiner et peindre,—deux mots qui, d’ailleurs, n’avaient aucun sens.
En vain, Mme Cézanne, la mère, et Marie Cézanne, la sœur, intervenaient en faveur du fils et du frère. Le père Cézanne ne cédait pas. La lutte, toutefois, heureusement pour Paul Cézanne, dura. Elle se prolongea pendant tout le temps qu’il fut placé chez un avoué, le plus inutilement du monde. Et, un jour de grâce enfin, le père Cézanne se rendit. Soit! On allait essayer! Et, mieux même, ce fut lui qui un beau jour se mit en route pour Paris, avec sa fille Marie, pour y conduire son fils.
Enfin, c’en était fini des rues tristes, des maisons jaunes à toits plats, des mornes colonnes du Palais de Justice, de la solennelle porte de la Faculté de Droit, et de tout enfin! A Paris, c’était Zola qui l’attendait, lui, Cézanne; c’était la peinture, c’était le Musée du Louvre; c’était son bonheur enfin épanoui, largement, complètement.
Le père Cézanne et Marie Cézanne repartis pour Aix, Cézanne s’installa dans un hôtel meublé de la rue des Feuillantines, et il choisit, pour y dessiner, l’Académie Suisse, sise au quai des Orfèvres.
Voici alors les débuts d’un autre Provincial à Paris.
Il va s’y comporter le plus timidement du monde, et en conservant tout son tempérament. S’il s’agit d’un déraciné, Cézanne l’est tout de suite, tout à fait, complètement, absolument; et, dans l’avenir, tant qu’il restera à Paris, nous pouvons déjà dire qu’il sera de tous les Provinciaux venus pour conquérir Paris celui qui aura été le plus dépaysé, c’est-à-dire qu’il gardera jusqu’à la fin le sang de son terroir, l’empreinte de sa Province et de sa Provence, jusqu’à l’accent qu’il ne pourra et qu’il ne cherchera du reste jamais à transformer.
Tout bourru il était à Aix, tout bourru il restera à Paris. Il ne perdra point sa timidité de jeune homme pas affranchi; il travaillera ici comme il travaillait déjà là-bas, grognon, de mauvaise humeur, emporté, incivil quand on l’agacera ou, si, devant lui, on affecte des attitudes poseuses, avec des propos qui lui soient hostiles.
Aujourd’hui l’Académie Suisse n’est plus; elle a disparu en même temps que le cabinet du dentiste populaire Sabra, qui fut longtemps installé à la tête du pont Saint-Michel. Les agrandissements du Palais de Justice ont jeté bas ce coin si pittoresque du vieux Paris.
L’Académie Suisse et le cabinet Sabra se trouvant sur le même palier, vous voyez les divertissantes confusions qui éclataient. Seuls, les patients les prenaient mal; et beaucoup devaient s’enfuir à tout jamais en voyant chez le dentiste—s’étant trompé de porte—des modèles nus dressés ou assis sans pudeur.
Cette Académie Suisse était une académie entièrement libre. Personne n’y venait corriger. Elle ouvrait de bonne heure, dès six heures en été; puis, passé l’après-midi, il y avait un cours de sept heures à dix heures du soir. Trois semaines, on avait un modèle homme; l’autre semaine du mois, un modèle femme.
Cézanne s’y montra très assidu. Il y connut Guillaumin—et Pissarro, alors installé à la Varenne-Saint-Hilaire et qui ne travailla jamais chez Suisse, mais qui souvent y venait voir son ami Oller.
C’est dans ce temps là aussi que Cézanne et Guillaumin souvent partaient de concert pour aller dessiner et peindre—avec quelle technique serrée!—dans l’ancien parc d’Issy-les-Moulineaux, aujourd’hui morcelé.
Tous deux—et d’autres peintres mêmement—croyaient alors violemment en Courbet.
Mais Cézanne, lui, vénérait aussi Rubens et Delacroix. Et déjà il exprimait rageusement et fortement ses opinions, ne ménageant point les interlocuteurs qui ne pensaient pas comme lui.
Il avait retrouvé Zola avec joie; Zola déjà nettement doctrinaire, et qui ne songeait, lui, qu’à arriver. Cézanne, très sensible, subit là le premier choc à son amitié de collège. Il ne retrouvait pas le Zola qu’il avait connu à Aix; et son ennui fut tel que, pris brusquement de regret, il ne tint pas en place qu’il ne repartît pour Aix, ne sachant trop comment il allait maintenant vivre.

LE JAS DE BOUFFAN
(La Serre)
PHOTO DE L’AUTEUR
C’était en quelque sorte un autre retour d’enfant prodigue. Le père Cézanne ne cacha point sa joie de reprendre son fils. Mais à Aix l’envoûtement de Paris recommença; Zola relança Cézanne par de nouvelles lettres ardentes, et voilà Cézanne renouvelant ses supplications pour repartir. Sa mère lui vient encore en aide; il repart.
Il se logea cette fois Boulevard Saint Michel, reprit ses séances à l’Académie Suisse, et décida qu’il se présenterait au concours d’admission de l’Ecole des Beaux-Arts.
Il fut refusé. Mais il trouva une compensation à cet échec en se liant avec Guillemet, qui, venu à Aix, obtint du père Cézanne que son fils aurait enfin une pension régulière pour qu’il pût désormais être peintre à Paris.
M. Vollard (dans son livre si curieusement pittoresque), M. Vollard raconte:
«En cette année 1863, Cézanne fit la connaissance de Renoir. Celui-ci vit un jour entrer dans son atelier un de ses amis, Bazille, avec deux inconnus qu’il présenta à Renoir: «Je vous amène deux fameuses recrues.» C’étaient Cézanne et Pissarro. Cézanne connut aussi vers la même époque Manet, à qui il fut présenté par Guillemet. Il fut tout de suite pris par la force de réalisation de Manet. «Il crache le ton!» s’exclamait-il, seulement, à la réflexion, il ajoutait: «Oui, mais il manque d’harmonie et aussi de tempérament.» C’était d’ailleurs bien simple. Cézanne avait divisé la peinture en deux genres: la peinture «bien couillarde» la sienne; et la peinture qui n’était pas «couillarde», celle des «ôttres». De cette seconde catégorie était notamment Corot, dont Guillemet lui parlait sans cesse; à quoi Cézanne répondit un jour: «Ton Corrot, tu ne trouves pas qu’il manque un peu de tempéremmenn?» Il ajouta: «Je viens de terminer le portrait de Valabrègue (un ami connu chez Zola), le point lumineux sur le nez, c’est le vermillon pur!»
Manet trônait alors au café Guerbois, situé à l’entrée de l’Avenue de Clichy, et où se rassemblaient les jeunes peintres et les écrivains de la pseudo-école des Batignolles.
Au café Guerbois, comme dans toutes les parlottes de ce genre, on élaborait toutes les conquêtes de l’avenir; on préparait tous les champs de bataille pour y combattre tout ce qui était officiel. Fantin-Latour, Guillemet, les graveurs Desboutins et Belot, le critique Duranty, le sculpteur et poète Zacharie Astruc, Léon Cladel, Burty, Degas, Stevens, Monet et Renoir, Bazille et Zola y étaient les plus assidus. D’abord enrôlés pour les mêmes victoires, sous la même bannière, au fur et à mesure que les jours passaient, des antipathies, des jalousies, des haines ne tardèrent point à éclater entre tous ces commensaux. Cézanne, de plus en plus déraciné et s’ennuyant de plus en plus, se laissait traîner dans cette fosse aux ours; et déjà il enrageait d’entendre Zola se célébrer tous les soirs. Puis, Manet également l’irritait. L’élégance, le parisianisme, l’esprit et les allures de ce peintre dandy lui étrillaient fortement les nerfs; car, lui, Cézanne, il se rendait compte qu’il pesait peu, avec sa mise presque bohême, même et surtout avec son sacré accent, qui eût pu sonner moins avec un parler lent; mais il n’avait nul moyen de calmer la violence de ses emportements, condamné à rester en somme un sacré bougre de Provençal, à coup sûr mal embouché. Et puis quoi, ce Manet, son originalité, ne sautait pas tellement aux yeux! Il suivait toujours quelqu’un en somme; et ses sacrés noirs qu’on vantait tant, il les avait bien volés aux Espagnols; même les sujets venaient de Goya; et ce que c’était autrement moins fort! Zola avait beau défendre Manet; il n’en était pas moins vrai que ce n’était pas le grand homme qu’il voulait imposer. D’où discussions véhémentes, frénétiques, dont Zola sortait découragé, se disant déjà que Cézanne, hélas! n’arriverait jamais à rien, puisqu’il ne comprenait décidément pas toute la souveraineté que Manet affirmait.
Car, en somme, toute la vérité était là: Manet était déjà consacré par de vraies et hautes œuvres; tandis que Cézanne, lui, n’avait peint que des portraits en somme barbares ou des compositions, comme la Femme à la puce ou l’Après-midi à Naples, presque ridicules. Et tout cela sculpté, raviné, crépi dans une pâte épaisse, lourde, comme un champ retourné.
Et, inexorablement, Zola citait à Cézanne, dans cet ordre d’idées: Le Jugement de Pâris; le portrait du nègre Scipion; le Portrait de Marion; etc., etc. A quoi, Cézanne, bondissant, répondait que lui, au moins, il n’était le plagiaire de personne; pas plus de Courbet que de Delacroix; et que s’il s’infiltrait tout de même du romantisme dans ses œuvres; eh bien! que ce romantisme là était à lui, bien à lui; et qu’il avait bien le droit, pour ses débuts, de vivre dans l’atmosphère de son temps; et que, ma foi, plus tard, on verrait!
Ce sont certainement ces discussions qui poussèrent Cézanne à envoyer au Salon officiel, en 1866, ces deux tableaux déjà nommés: L’après-midi à Naples et la Femme à la puce. Reçu, il en tirait une force incontestable. Il s’était soumis au jugement des autres; et ces autres le considéraient, qu’on le voulût ou non, comme un peintre.
Mais les deux tableaux furent refusés. C’est alors qu’il écrivit au Surintendant des Beaux-Arts, de Nieuwerkerke, pour lui dire «qu’il ne peut accepter le jugement illégitime de confrères auxquels il n’a pas donné lui-même mission de l’apprécier...» et il demande «à en appeler au public et être exposé quand même!» et il termine: «que le salon des Refusés soit donc rétabli!»
Vaine protestation! Il put d’ailleurs vite se consoler en pensant que beaucoup de vrais peintres, ont été logés à la même enseigne. Et enfin, Monet. Renoir, Pissarro ne triomphent pas plus que lui. Ils se débattent tous dans les pires ennuis: tandis que, lui, en somme, il a sa pension régulière et tout le temps devant lui pour l’imposer quand même sa sacrée peinture à coups de poing, à coups de pied dans le c... de tous «ces salops-là qui officient sur les ordures de leur Salon!...»
Que si, ici, l’on s’étonne de me voir présenter ainsi Cézanne, violent et peu courtois,—reproche qui a été maintes fois adressé au livre de M. Vollard,—il faut tout de même se dire que Cézanne était et restait un homme incivil, malgré l’exemple du dandy Manet, lui, spirituel et de correcte distinction.
Aussi, ne faut-il pas s’étonner si Cézanne ne tenait guère en place, regrettant Aix quand il était à Paris, et Paris quand il était à Aix. Heureusement quand il se vomissait trop, il f... le camp là où il pouvait voir des tableaux de Delacroix et de Courbet.
Il les admirait profondément, certes; mais après les avoir bien admirés, il s’entêtait dans sa peinture à lui, et rageusement, avec la ténacité d’un bœuf, mais s’irritant contre tout, il se remettait à maçonner à pleine truelle dans le plâtre coloré qu’il arrachait de sa palette. Et, assurément, nul ouvrier ne fut plus opiniâtre, plus passionné que lui. Ah! alors, on pouvait bien lui demander après d’aller poser chez Guerbois. La vérité, c’est que de plus en plus, il les em... tous ces lapins là-bas qui soignaient leurs propos, qui faisaient des effets de cravate, qui éculaient les potins de Paris, qui s’ahurissaient des prix de vente des tableaux officiels, qui, tout en proclamant leur indépendance, se révélaient plus bas que des Bourgeois et plus bêtes que des Politiciens. Ah! non! mille fois non! tout valait mieux que çà, même Aix;—et, Cézanne, alors abreuvé de dégoût, du dégoût de tous ses confrères, brusquement, repartait.
Il y avait alors au Jas de Bouffan une vaste salle, au rez-de-chaussée, à usage de buanderie, et qui servait plutôt de dépôt pour les objets les plus hétéroclites. Mais au moins les murs en étaient à peu près nus; et cela un jour donna l’idée à Cézanne de peindre à même ces murs.
Il commença par le portrait de son père, qu’il représenta assis dans un fauteuil et lisant son journal: puis vint le portrait de son ami Achille Emperaire, un peintre aixois, qu’il appelait, en mémoire d’Homère, le bouillant Achille, alors que le bougre était simplement le plus pacifique et le plus sommeillant des lendores.
Et, ensuite, comme il exécrait Ingres, il entreprit, à la manière du peintre raphaélesque, de représenter dans le fond de la salle les quatre Saisons, d’après des figures d’un numéro du Magasin pittoresque. Ces quatre grandes figures mâtinées dirait-on, avant la lettre, au moins pour le premier, du douanier Rousseau et de Botticelli, furent signées: Ingres, et datées: 1811.
Enfin, coup sur coup, Cézanne peignit toujours sur les murs, le bal champêtre, d’après Lancret; le Christ ressuscitant Lazare; la Madeleine repentante; les Contrastes (deux têtes: une tête d’homme et une tête de femme);—enfin une grosse Baigneuse, vue de dos.
Le père Cézanne laissait faire son fils. Tout de même, à propos de cette dernière peinture, le père Cézanne crut devoir dire un jour: «Voyons, Paul, tu as des sœurs; comment as-tu pu faire une grosse femme nue?» A quoi, Cézanne de répondre: «Mais, mes sœurs n’ont-elles pas des culs comme vous et moi?»
Au fond, Cézanne se plaisait dans ce Jas de Bouffan, où enfin il trouvait la paix! C’était tout autour de lui la solitude, le silence; et si un chien de la ferme aboyait (il avait horreur des chiens), vite, on galopait aux trousses de la bête pour la museler. A part cela, tout autour de lui, des champs, de la lumière.
Il avait installé un petit atelier au dernier étage, sous la corniche à la gênoise; et de là il s’abreuvait de l’admirable montagne Sainte-Victoire, toute gorgée de blancheur lumineuse et de virginale splendeur, qu’il a peinte tant de fois.
Là, il vivait chez lui, tout seul, insociable, dans le désordre le plus complet, écrasant ses couleurs sur le parquet, tout badigeonné lui-même d’essence et de blanc, et de bleu, et de vert et de jaune, les cheveux fous, pas entretenus, traitant vraiment sa toilette comme une chose absolument indifférente.
Et lui seul pouvait pénétrer dans ce petit atelier. Lui seul pouvait marcher dans ce désarroi des fruits jetés tout à vrac, dans ce pêle-mêle de serviettes, de pots, de compotiers, de tous les objets enfin qui pouvaient poser pour ses natures mortes. Et l’on avait reçu l’ordre de ne jamais rien enlever, de ne toucher à rien, de n’épousseter rien. Les fruits pourrissaient, les fleurs séchaient, un amas de couleurs raclées et de tubes exhaussait le plancher; n’importe, personne n’entrait dans l’atelier de M. Paul. Il en descendait à certaines heures, hirsute, hagard, comme échappé à une torture; et gardant encore dans ses yeux l’épouvante de la farouche lutte qu’il venait de subir contre la matière.
Certes! Il y a déjà eu des bœufs, si je puis ainsi dire, dans la peinture; mais aucun n’a souffert, n’a creusé son sillon, n’a peiné comme celui-là. Ah! ce n’était pas le travail élégant, comme dans une vitrine que le passant regarde, de M. Manet! Et les peintres qui peignent la cigarette, la pipe à la bouche, satisfaits, se rapprochant, se reculant, le genou arrondi et la bouche souriante! Cézanne était, lui, une sorte de forçat de la Peinture; une sorte de pauvre hère damné, attaché comme à une tâche horrible. Il suait, il geignait, il rageait, il jurait; la Peinture était pour lui un labeur d’Enfer, d’où il sortait congestionné, brûlant, les yeux fous—et vraiment peu disposé à faire figure de peintre parisien, aimable, courtois et précieusement habillé!
*
* *
La guerre de 1870. Cézanne accourut au Jas de Bouffan. Des gendarmes vinrent alors pour l’emmener. Mais ne se sentant aucun goût pour porter le harnois, il ne se montra point; et, dans la nuit qui suivit l’apparition des Pandores, il s’en fut tout d’une traite jusqu’à l’Estaque, près de Marseille, où, là, il resta jusqu’à la fin de la guerre.
Ne l’en accablez pas! Il ne fut pas le seul peintre ou sculpteur défaillant. Pendant ce temps, en effet, si Bazille se faisait tuer à la bataille de Beaune-la-Rolande, Pissarro se trouvait à Londres; Monet, le solide Monet était à Amsterdam; Zola à Bordeaux; Rodin à Bruxelles; et Renoir, dans je ne sais quel Cagnes! Il est vrai que Manet, demeuré, lui, à Paris, sauva, comme Bazille, l’honneur, en devenant officier dans l’état-major de la garde nationale.
La paix signée, convalescente, le café Guerbois, lui, en mourut. Manet resta à Paris; Pissarro s’installa à Pontoise; Monet, à Argenteuil; Sisley, à Voisins; et Cézanne partit pour Auvers-sur-Oise, près Pontoise.

L’ANCIEN ATELIER DE PAUL CÉZANNE
Chemin des Lauves à Aix-en-Provence
Au sujet des influences subies par Cézanne, et que j’ai déjà notées, M. Théodore Duret a pu écrire (Les peintres Impressionnistes):
«Il faut bien expliquer que les influences successives subies par Cézanne, ne marquent pas des manières différentes absolument tranchées. Avec lui, il s’agit d’un homme très ferme, qui s’est tout de suite engagé dans une voie certaine. En effet, le choix de ses sujets, les limites dans lesquelles il entend se tenir ont été promptement fixés. Sauf au premier moment où, sous l’influence de Delacroix, il peint quelques compositions romantiques, il n’a jamais été attiré que par le spectacle du monde visible. Il n’a point recherché les sujets descriptifs, il a ignoré les emprunts littéraires. L’expression de sentiments abstraits, d’états d’âmes, lui est toujours restée inconnue. Il s’est d’abord consacré à peindre ce qui peut être vu par les yeux, les natures mortes, les paysages, les têtes ou portraits et, comme une sorte de couronnement, des compositions, mais d’ordre simple, où les personnages sont mis côte à côte, sans se livrer à des actions singulières, surtout pour être peints.
«Le terrain, continue M. Théodore Duret, sur lequel il entend se tenir, étant tout de suite délimité, quand on parle des influences subies, il s’agit en réalité de questions de technique, de la gamme des tons, des valeurs de palette, qu’il doit d’abord aux devanciers. C’est donc surtout son coloris qui a passé par des phases diverses, avant d’être pleinement fixé. C’est l’aspect extérieur qui change et se modifie, jusqu’au jour où il prend son caractère définitif par l’adoption de la peinture en plein air.»
La peinture en plein air! C’était surtout pour s’y adonner en toute quiétude, qu’il résolut de rejoindre Pissarro qui l’appelait auprès de lui. Et là, à Auvers, Cézanne devait rencontrer un autre ami fervent en la curieuse personne du docteur Gachet.
Avec le plus entier respect, mais en montrant le docteur Gachet tel qu’il était, je tiens, car je lui dois cet hommage, à parler ici un peu longuement de cet incontestable premier amateur de la peinture nouvelle.
Le docteur Gachet était à ce moment-là un vieillard hoffmannesque, très maigre, de taille moyenne, médecin de la compagnie du chemin de fer du Nord. Il habitait à Auvers une ancienne pension de famille, contiguë à un cimetière désaffecté dont les ossements parfois tombaient dans la petite propriété. «Vos victimes qui se vengent!» disait un de ses familiers—et le père Gachet ne se fâchait point. Il avait un fils, Paul, et une fille, Clémentine. Sa femme était morte depuis long-temps. Le docteur Gachet était «sans âge» quand il mourut; l’acte de décès, au surplus, n’apporta aucune précision, l’indication de l’âge ayant été volontairement omise, par coquetterie du vieillard. Ses deux enfants marchaient disciplinés, à la voix ou au son d’un sifflet qu’il portait à son cou. Docteur homéopathe, il soignait, naturellement, par de minuscules pilules et faisait boire sans cesse de la tisane à ses enfants et à ses invités.
C’était une vieille gouvernante, Madame Chevalier, qui avait élevé les enfants. Alors, ayant des loisirs, le docteur Gachet, fou furieux de peinture, s’était mis, lui aussi à faire de la peinture, et, par surcroît, de l’eau-forte. Il se réfugiait dans un petit atelier inviolable, dans son grenier; petit atelier où l’on arrivait par une longue échelle et par une trappe; et là, il peignait ses sujets favoris: des têtes de cochons et des chats. Il signait ses toiles Van Ryssel et prétendait descendre du peintre Van Mabuse.
Il y avait comme hôtes encore, dans la petite maison également singulière du docteur Gachet,—il y avait une vieille chèvre diabolique, sans poils, ainsi qu’une vieille descente de lit toute pelée, et que l’on appelait Henriette; puis une non moins vieille paonne, pareillement sans plumes, toute ridée, que pourchassaient du matin au soir une trôlée de chats, toujours au nombre de seize à dix-huit.
Les accoutrements du docteur Gachet étaient non moins curieux. En hiver, pour cheminer dans Auvers,—car il soignait gratuitement et en cachette les indigents du pays (ses fonctions de médecin de la Cie du Nord lui interdisant d’exercer dans Auvers), en hiver, il portait de hautes bottes qui lui venaient au-dessus des genoux, une petite fourrure de martre (tête et pattes!) autour du cou, une longue redingote et un bonnet de fourrure.
En été, il arborait un ample chapeau aux bords ballants, une ombrelle blanche doublée de vert, une redingote en alpaga, et des bottines à élastiques.
Autre singularité: il portait les cheveux fins, comme du duvet de canard. Il les teignait lui-même en un jaune si ardent, que Gœneutte l’avait surnommé: le docteur Safran.
Vigilant philanthrope, il avait installé au faubourg Saint-Denis une clinique; et c’était ceci les buts de sa vie: soigner les gens, peindre et adorer la peinture.
La peinture! surtout et seulement celle qui venait d’apparaître. On connait le merveilleux portrait que Van Gogh a réalisé d’après lui: le chef couvert d’une casquette en toile, très plate, avec visière de celluloïd.
C’est Van Gogh qui, à propos du docteur Gachet, écrivait à son frère Théo les extraits de lettres suivants: Juillet 1890. «J’ai vu M. le Dr Gachet, qui m’a fait sur moi l’impression d’être assez excentrique, mais son expérience de docteur doit le tenir lui-même en équilibre en combattant le mal nerveux, duquel certes il me paraît attaqué au moins aussi gravement que moi...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Probablement tu verras le Dr Gachet cette semaine—il a un très beau Pissarro, hiver avec maison rouge dans la neige, et deux beaux bouquets de Cézanne. Aussi un autre Cézanne du village.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Et d’une nouvelle lettre:
«La maison du Dr Gachet est pleine de vieilleries noires, noires, noires, à l’exception des tableaux impressionnistes. L’impression qu’il a faite sur moi n’est pas défavorable. Causant de la Belgique et des jours des anciens peintres, sa figure raidie par le chagrin redevient souriante, et je crois bien que je resterai ami avec lui et que je ferai son portrait.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un autre jour:
«Aujourd’hui, j’ai revu le Dr Gachet et je vais peindre chez lui mardi matin, puis je dînerai avec lui et après il viendrait voir ma peinture. Il me paraît très raisonnable, mais est aussi découragé dans son métier de médecin de campagne (sic) que moi de ma peinture.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cet extrait de lettre, encore:
«Mais tu feras certes avec plaisir plus ample connaissance avec le Dr Gachet et il y compte déjà, en parle toutes les fois que je le vois, que vous tous viendrez (Théo, sa femme, Jo et l’enfant). Il me paraît certes aussi malade et ahuri que toi ou moi, et il est plus âgé et il a perdu il y a quelques années sa femme, mais il est très médecin et son métier et sa foi le tiennent pourtant. Nous sommes déjà très amis.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Je travaille à son portrait, le tête avec une casquette blanche, très blonde, très claire, des mains aussi à carnation claire, un frac bleu et un fond bleu Cobalt, appuyé sur une table rouge, sur laquelle un livre jaune et une plante de digitale à fleurs pourprés.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«M. Gachet est absolument fanatique pour ce portrait et veut que j’en fasse un pour lui, si je peux, absolument comme cela, ce que je désire faire aussi.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Puis j’ai peint chez lui deux études, que je lui ai données la semaine passée, un aloès avec des cyprès, puis dimanche dernier des roses blanches, de la vigne et une figure blanche là-dedans.»
«Je ferai très probablement aussi le portrait de sa fille qui a 19 ans.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Maintenant rien, absolument rien ne nous retient ici, que Gachet—mais celui-là restera un ami à ce que je présumerais. Je sens que chez lui je peux faire un tableau pas trop mal toutes les fois que j’y vais et il continuera bien de m’inviter à dîner tous les dimanches et lundis (Et Van Gogh dit cependant que c’est une corvée, car on y mange trop: 4 ou 5 plats!)...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Gachet a un Guillaumin, femme nue sur un lit que je trouve fort belle, il a aussi un très ancien portrait de Guillaumin par lui»...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extrait d’une autre lettre:
«Mais sa maison, tu verras, c’est plein, plein, comme un marchand d’antiquités, de choses pas toujours intéressantes. Mais dans tout cela il y a ceci de bon que pour arranger des fleurs ou des natures mortes, il y aurait toujours de quoi.»...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ces mots encore d’une lettre à Gauguin:
«Maintenant j’ai un portrait du Dr Gachet à expression navrée de notre temps.»...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D’une lettre enfin à son frère Théo.
«Hier et avant hier j’ai peint le portrait de Mlle Gachet que tu verras j’espère bientôt, la robe est rose, le mur dans le fond vert avec un point orangé, le tapis rouge avec un point vert, le piano violet foncé, cela a 1m de haut sur 50 de large. (Mlle Gachet jouait du piano et de l’orgue. Le morceau favori, imposé par son père, était les Vêpres Siciliennes!)»...
*
* *
Cézanne, appelé à Pontoise par Pissarro, tombait en un milieu favorable. Le Dr Gachet ne demandait qu’à accueillir Cézanne, cet ami que lui amenait Pissarro. Du reste Pontoise abritait tout un groupe de peintres; et put former ce qu’on a appelé depuis l’école de Pontoise. Cordey, le bon vivant Cordey, le Cordey des plantureux repas, pour qui les seules occupations louables étaient la pêche à la ligne, la peinture et surtout les savoureuses goinfreries; Cordey, qui, encore plus que Sisley, eut un métier pictural à toutes petites touches; Vignon, un peintre trop injustement oublié; Guillaumin, le robuste Creusois; Pissarro,—étaient les plus ardents tenants de la peinture en plein air; et Cézanne, arrivant au milieu d’eux, trouvait enfin, mieux qu’au café Guerbois, les confrères qu’il méritait.
Du reste, son amitié pour Pissarro fut tout de suite certaine; et il s’installa avec lui à l’Ermitage, à Pontoise. Ensemble, ils parcoururent tous les champs de Pontoise à Auvers, descendant souvent aux bords de l’Oise, peignant des maisons, des cours de villages, des sentes aux choux, des bois et des prés. Les paysans qui sont bien moins bêtes que les amateurs connurent vite les deux peintres amis; et jamais ils ne vinrent les importuner. Quelquefois, ils regardaient les tableaux en passant et s’éloignaient sans rien dire; mais pas toujours sans remarquer; car c’est l’un de ces paysans qui me disait si justement un de ces étés derniers: «Monsieur, j’ai vu bien souvent les tableaux de MM. Cézanne et Pissarro. M. Pissarro, en travaillant, piquait (et mon paysan faisait le geste) et M. Cézanne plaquait (autre geste).»
Je vais désoler maintenant les amateurs sérieux en disant que les premiers amateurs des tableaux de Pissarro et de Cézanne, en ce coin bénit de Pontoise et d’Auvers, furent un ancien instituteur, M. Rouleau, et un épicier, rue de la Roche, à Pontoise, M. Rondès. Mais, bien entendu, le Dr Gachet restait le plus vigilant et le plus enthousiaste des amateurs.
Ce fut lui qui poussa Guillaumin et Cézanne à faire de l’eau-forte, à l’instigation de son ami Richard Lesclide, un journaliste, qui publiait un album: Paris à l’eau-forte. Il est vrai que si Guillaumin grava plusieurs planches, Cézanne, lui, s’en tint à trois planches en tout, pas une de plus: un paysage (reproduit dans le livre de M. Vollard);—une tête de femme (reproduite dans l’album consacré à Cézanne par M. M. Bernheim-Jeune); enfin le portrait de Guillaumin assis par terre, les bras croisés, gravé directement d’après nature et reproduit dans le livre de M. Théodore Duret: (Les peintres impressionnistes).
La vive joie de Cézanne fut de peindre continuellement en plein air, entraîné, on peut le dire, par son ami Pissarro, qui grava lui-même un jour (en 1874) le portrait de Cézanne, hirsute, avec sa casquette de chasseur de canards et une vaste houppelande de roulier, sa tenue pour affronter la bise et les frimas.
Pour Cézanne, la peinture, M. Vollard nous l’a dit, devait être couillarde; et la sienne l’est déjà absolument.
En cessant de hanter les jardins de Rubens, de Delacroix et de Courbet, il devient un féroce maçonnier, j’y insiste, établissant à furieux coups de spatule de solides plans, qu’il écrase rageusement et qu’il râcle dès que l’œuvre lui semble débile. Alors il se rejette sur son outil, et il entre maintenant à coups de poing dans la toile. Là-dedans, des bleus, des vermillons, des jaunes, des verts composent de puissantes harmonies et d’étranges sonorités. On n’a pas encore vu un tel chaos enragé de tons; et cela est si âpre qu’aux premiers tableaux de Cézanne, l’élite, déséquilibrée, s’égaye. Pourtant, c’est déjà splendide, et, d’un coup, d’une définitive originalité.
Un excès de sensibilité encore invu, une folie de peindre jamais départie à un humain, et voici Cézanne plantant des compotiers et des pommes, des litres et des cruches, des maisons et des arbres, des crânes et des torses, tout ce qui vit dans le silence, tout ce qui croît, tout ce qui se confronte dans la lumière et dans l’ombre. C’est, dans le mépris déjà total des autres peintres, une telle emphase de suprématie que tout à côté est vain, que tout glisse à la miniature et s’effondre.
Cézanne continue son labeur. Il interprète le monde. Le monde, nous ne l’avions pas vu, nous, au travers de la vermine des anecdotes et de l’incroyable gageure des virtuoses. Les Musées nous avaient pourris jusqu’aux moelles; à des écoles avaient succédé des écoles; on s’écroulait sous l’amas d’inextinguibles redites; on nourrissait la haine innée du neuf, de l’apport encore insoupçonné d’un homme abandonnant enfin les vieilles recettes pour découvrir de lumineuses vérités et d’extraordinaires beautés.
Cézanne, comme un fou, s’acharne. Il crée des nus, des natures mortes, des paysages. Il crée trop abondamment pour réaliser chaque fois une œuvre de longue durée à travers le temps. Il lui vient la volonté d’être lent sur son effort, pour l’acheminer plus loin. Au maçonnage, il substitue la peinture des tons sur tons et des tons juxtaposés, sans épaisseur. L’aube se lève, il est déjà au pied de l’œuvre à créer. Le soleil monte à l’horizon; et, lui, Cézanne, le bon ouvrier, il guette la sève de la vie qu’il voit sourdre des entrailles profondes de la terre. Et il adore la route, les terrains rouges, les arbres dont les plus légers rameaux frémissent en un hosanna de résurrection.
Pour la première fois, un peintre qui est déjà une sorte de roi parmi les peintres, ajoute son âme à l’âme des choses. Ah! qu’il convient donc de la chérir enfin la nature, d’un amour inapaisable, et de suivre touche à touche l’agencement de sa vie organisée! A-t-elle été assez polluée, en effet, par les prestes «pigeurs de motifs», par toute une horde qui l’a débitée en tronçons de paysages, en arrangements de décors, le tout assaisonné à l’essence ou marinant dans des bains d’huile! A-t-elle, jusqu’à ce jour, été assez malmenée, la splendide Terre, qui, aux quatre saisons, offre pourtant, sans trêve, le puissant enchantement de ses incantations!
Avec Cézanne, tout est révolu. Ce parfait magicien dévoile les plus mystérieux apprêts des roches et des arbrisseaux, des maisons et des collines. Grave et mystique, il crée solitairement; et il n’a nul besoin de notre admiration à l’instant même; il lègue aux âges futurs son œuvre, les témoignages de sa probité patiente et volontaire.
Il est farouche, et il va être honni; c’est qu’il hait les autres hommes, et qu’il n’attend rien d’eux. Pour créer sa peinture, il faut qu’il soit un silencieux et irritable ermite, n’ayant de colères à passer que sur ses toiles ou sur son chevalet dressé en pleine nature comme un appareil de supplice. Plus tard, le regardera-t-on peindre, il sera comme pris au piège; et il se débattra en lançant des jurons. C’est que chaque touche lui cause une véritable angoisse, et attire parfois à son visage rutilant, à son front chauve, le sang de la congestion. Il est courroucé quand il peint. Cet homme lourd et maladroit enfante déjà ses chefs-d’œuvre en rugissant.
N’importe, combien sortent de ses mains aussi purs, aussi profonds, aussi porteurs de beauté que s’ils avaient été engendrés dans la joie! Et, devant tels de ses paysages, par exemple, n’avez-vous point compris que Cézanne, a, lui aussi, peu à peu arraché la vie aux arbres, aux ondes, aux roches, aux maisons, pour la transfuser dans ses peintures, dans les arbres, dans les ondes, dans les roches et dans les maisons, recréés par lui, dans le plus persévérant, le plus raisonnable et le plus pénétrant amour qui ait jamais gonflé le cœur d’un homme?
*
* *
Faut-il maintenant citer des toiles? A quoi bon? Il apparaît déjà une si parfaite unité dans cette vie de peintre, que c’est tout un ensemble qu’il conviendrait de nommer. Voici un homme qui a peint le Nu, le Paysage, le Portrait, la Nature morte. Si, cependant, vous aimez les détails, voici quelques noms de toiles, de l’année 1870 à l’année 1874: Une première Tentation de Saint Antoine; Scène de plein air; Les toits rouges; la Promenade; la Nouvelle Olympia (qui appartint au Docteur Gachet); l’homme au chapeau de paille; la Maison du pendu (collection Camondo, aujourd’hui au musée du Louvre); la Chaumière dans les arbres; la seconde Tentation de Saint Antoine; etc.
*
* *
C’est à ce moment que le père Tanguy connut Cézanne, dont il devait être à peu près le premier marchand.
Le père Tanguy! Figure anecdotique, ce brave homme garde la gloire d’avoir été le premier marchand, non seulement de Cézanne, mais encore de Van Gogh.
Breton et marié, il avait débuté à Paris comme employé à la Compagnie de l’Ouest. Puis, ce poste quitté, il avait pris celui de broyeur de couleurs dans la maison Edouard. Mais la nostalgie des champs le minait; et un jour le voici préparant les couleurs pour lui-même et les colportant ensuite à Fontainebleau, à Argenteuil, à Pontoise, partout où il était à peu près sûr de débusquer des peintres sur le motif. C’est ainsi qu’il connut Monet, Pissarro, Cézanne et Renoir.
Mais, par dessus le marché, Tanguy était un humanitaire ardent. On le trouve donc naturellement en 1871 parmi les fédérés. Il est pris. Grâce à un secours inespéré, il se tire tout de même de sa geôle. Et, revenu à Paris, il lâche la vente des couleurs, pour s’établir marchand de tableaux, rue Clauzel, une boutique dans laquelle il entasse des toiles de Cézanne et de Van Gogh.
Tableaux dont il ne tira d’ailleurs aucun profit; si bien que lors de son décès, en 1894, Octave Mirbeau ayant organisé une vente à l’hôtel Drouot, au profit de la veuve et des enfants de Tanguy, la vente produisit à peine, tous frais payés, 10.000 francs;—et des tableaux de Cézanne s’étaient vendus entre 45 francs et 215 francs.
Quel écart entre les prix de vente depuis! Mais les amateurs n’ont jamais de flair; ce sont des sortes de nigauds usés, vidés, ayant perdu complètement l’odorat et la vue. Cézanne, heureusement, pensait mieux de lui-même. Il écrivait à sa mère, le 26 septembre 1874:
«Ma chère Mère,
«J’ai tout d’abord à vous remercier bien de penser à moi. Il fait depuis quelques jours un sale temps et très froid.—Mais je ne souffre de rien, et je fais bon feu.
«Ce sera avec plaisir que je recevrai la caisse annoncée, vous pouvez toujours l’adresser rue de Vaugirard, 120, je dois y rester jusqu’au mois de janvier.
«Pissarro n’est pas à Paris depuis environ un mois et demi, il se trouve en Bretagne, mais je sais qu’il a bonne opinion de moi, qui ai très bonne opinion de moi-même. Je commence à me trouver plus fort que tous ceux qui m’entourent, et vous savez que la bonne opinion que j’ai sur mon compte n’est venue qu’à bon escient. J’ai à travailler toujours, non pas pour arriver au fini, qui fait l’admiration des imbéciles.—Et cette chose que vulgairement on apprécie tant, n’est que le fait d’un métier d’ouvrier, et rend toute œuvre qui en résulte inartistique et commune. Je ne dois chercher à compléter que pour le plaisir de faire plus vrai et plus savant. Et croyez bien qu’il y a toujours une heure où l’on s’impose, et on a des admirateurs bien plus fervents, plus convaincus que ceux qui ne sont flattés que par une vaine apparence.
«Le moment est très mauvais pour la vente, tous les bourgeois rechignent à lâcher leurs sous, mais çà finira.—
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Ma chère mère, bonjour à mes sœurs. Le salut à Monsieur et Madame Girard et mes remerciements.
Tout à vous, votre fils, PAUL CÉZANNE.»
En 1874, Pissarro, Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe Morisot, Guillaumin—et Cézanne les suivant, résolurent de faire une exposition spéciale, avec le concours de certains autres artistes, en tout une trentaine d’exposants, groupés sous ce titre vide: Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs.
Il convient de lire dans le livre de M. Théodore Duret: Les Peintres impressionnistes, toute l’histoire, heure par heure, des conciliabules; et ensuite le récit non moins historique des moqueries, des railleries et des explosions de fureur que cette manifestation déchaîna. Quand on songe à la ruée actuelle des amateurs, du plus pusillanime au plus cynique; à la ruée non moins forte des marchands, du plus ladre au plus prodigue, on éprouve vraiment une sensation délicieuse à la lecture des pages susdites. C’est un exposé total de l’imbécillité humaine; la sottise d’un troupeau qu’un bon berger ne peut pas arriver à conduire vers les routes sereines de la méditation. Et pourtant que de précautions ces peintres adoptèrent! Que de ruses et que de stratagèmes!
L’exposition eut lieu au Nº 35 du Boulevard des Capucines, une réunion de salles qui composait la photographie Nadar. L’exposition fut ouverte le 15 avril. On vint en foule; mais vraiment on se divertit. Le sieur Pierre Véron, Directeur du Charivari, fut chargé de régler le ballet des connaisseurs!
Ce qui est plus grave, c’est que Huysmans, l’admirable Huysmans, au lieu de soutenir quand même les défaillances de certains artisans de la peinture nouvelle, alors que les ricanements et les injures devaient se perpétuer pendant plus d’une trentaine d’années encore, publia ceci (L’Art moderne):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Ajoutez maintenant à l’insuffisance du talent, à la maladroite brutalité du faire, la maladie rapidement amenée par la tension de l’œil, par l’entêtement si humain de ramener à un certain ton aperçu et comme découvert, un beau jour, un certain ton que l’œil finit par revoir, sous la pression de la volonté, même quand il n’existe plus, par la perte de sang-froid venue dans la lutte et dans la constante âpreté des recherches, et vous aurez l’explication des touchantes folies qui s’étalèrent lors des premières expositions chez Nadar et chez Durand-Ruel. L’étude de ces œuvres relevait surtout de la physiologie et de la médecine. Je ne veux pas citer ici des noms, il suffit de dire que l’œil de la plupart d’entre eux s’était monomanisé; celui-ci voyait du bleu perruquier dans toute la nature et il faisait d’un fleuve un baquet à blanchisseuse; celui-là voyait violet; terrain, ciels, eaux, chairs, tout avoisinait, dans son œuvre, le lilas et l’aubergine, la plupart enfin pouvaient confirmer les expériences du Dr Charcot sur les altérations dans la perception des couleurs qu’il a notées chez beaucoup d’hystériques de la Salpêtrière et sur nombre de gens atteints de maladies du système nerveux. Leurs rétines étaient malades; les cas constatés par l’oculiste Galezowski et cités par M. Véron, dans son savant traité d’esthétique, sur l’atrophie de plusieurs fibres nerveuses de l’œil, notamment sur la perte de la notion du vert qui est le prodrome de ce genre d’affection, étaient bien les leurs, à coup sûr, car le vert a presque disparu de leurs palettes, tandis que le bleu qui impressionne le plus largement, le plus vivement la rétine, qui persiste, en dernier lieu, dans ce désarroi de la vue, domine tout, noie tout dans leurs toiles.»
Et Huysmans, après tout cela, convient lui-même que la peinture claire est sortie de ces «théories justes, dégagées de leurs applications maladroites.»
On conçoit alors que les Bourgeois soient bien excusables, quand ils renâclent pour la première fois devant une peinture invue.
En 1875, il n’y eut pas d’exposition. Mais Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe Morisot envoyèrent à l’Hôtel des ventes soixante-dix tableaux, dont le total de la vente, tant pour les tableaux retirés que vendus, ne dépassa point dix mille francs.
En 1876, seconde exposition des Impressionnistes (c’est le nom qu’on leur a décerné) cette fois dans les galeries Durand-Ruel, rue Le Peletier; mais Cézanne et Guillaumin ne sont pas représentés.
En 1877, nouvelle exposition à laquelle prend part Cézanne, au nº 6 de la rue Le Peletier, dans un appartement vide qui est à louer. Il a envoyé seize tableaux et aquarelles, des fleurs, des paysages, des natures mortes et le portrait d’un nouvel amateur, très épris de sa peinture: M. Choquet.
C’est à propos de cette exposition que Huysmans publia, touchant Cézanne, cette page pittoresque: (Certains):
«En pleine lumière, dans des compotiers de porcelaine ou sur de blanches nappes, des poires et des pommes brutales, frustes, maçonnées avec une truelle, rebroussées par des roulis de pouce. De près, un hourdage furieux de vermillon et de jaune, de vert et de bleu; à l’écart, au point, des fruits destinés aux vitrines des Chevet, des fruits pléthoriques et savoureux, enviables.
«Et des vérités jusqu’alors omises s’aperçoivent, des tons étranges et réels, des taches d’une authenticité singulière, des nuances de linge, vassales des ombres épandues du tournant des fruits et éparses en des bleutés possibles et charmants qui font de ces toiles des œuvres initiatrices, alors que l’on se réfère aux habituelles natures-mortes enlevées en des repoussoirs de bitume, sur d’inintelligibles fonds.
«Puis des esquisses de paysage en plein air, des tentatives demeurées dans les limbes, des essais aux fraîcheurs gâtées par des retouches, des ébauches enfantines et barbares, enfin, de désarçonnants déséquilibres: des maisons penchées d’un côté, comme pochardes; des fruits de guingois dans des poteries saoûles; des baigneuses nues, cernées par des lignes insanes mais emballées, pour la gloire des yeux, avec la fougue d’un Delacroix, sans raffinement de vision et sans doigts fins, fouettées par une fièvre de couleurs gâchées, hurlant, en relief, sur la toile appesantie qui courbe!
«En somme, un coloriste révélateur, qui contribua plus que feu Manet au mouvement impressionniste, un artiste aux rétines malades, qui, dans l’aperception exaspérée de sa vue, découvrit les prodromes d’un nouvel art, tel semble pouvoir ètre résumé, ce peintre trop oublié, M. Cézanne.
«Il n’a plus exposé depuis l’année 1877, où il exhiba, rue Le Peletier, seize toiles dont la parfaite probité d’art servit à longuement égayer la foule.»
De son côté, M. Théodore Duret remarqua fort justement que, de tous les exposants, Cézanne fut celui que la cohue malmena avec la plus basse sottise.
«A l’exposition de 1877, raconte-t-il, les Impressionnistes se produisant dans toute leur hardiesse, soulevaient une horreur générale et faisaient au public l’effet de monstres et de barbares. Mais celui d’eux tous qui causait l’horreur la plus profonde, qui plus spécialement que tous les autres faisait l’effet d’un vrai barbare, d’un vrai monstre, était Cézanne. En 1877, les souvenirs de la Commune demeuraient vivants et si les Impressionnistes furent généralements traités de Communards, ils le durent surtout à sa présence au milieu d’eux.»
Cézanne ressentit ces insultes. Il comprit aussi qu’il n’avait décidément rien à espérer du public. Sa peinture qui était issue de tout son sang et de tout son cœur, elle ne pouvait se ravaler à des concessions honteuses, rabaisser son originalité extrême, diminuer sa haute étrangeté; et, puisque c’était sur lui surtout que se déversaient les rires, les ricanements du public, eh bien! il n’avait qu’à ne plus exposer pour ne pas entraver ses co-exposants, avec lesquels d’ailleurs il ne se sentait lui-même nullement libre. Eux, peut-être, ils bâclaient des impressions, d’où leur nom d’Impressionnistes; mais lui, sa peinture, arrachée à ses entrailles, exprimée avec la souffrance la plus complète, achevée avec le poids de la plus vive douleur, qu’est-ce qu’elle pouvait bien avoir de commun avec la peinture des autres, même en admettant que cette peinture-là fût, elle aussi, nouvelle? Lui, Cézanne, en quoi pouvait-il suivre l’art en somme gracieux, léger, semblant facile, de ses camarades Renoir ou Monet? Il ne se sentait pas la santé de ces gaillards-là, troussant et retroussant la peinture à pleins désirs. Pas davantage l’art épinglé de Sisley ne ressemblait à son labeur, à lui. Seul Pissarro labourait durement, profondément son champ; mais il avait tout de même une virtuosité certaine. Alors, puisqu’il était bien acquis que, lui, Cézanne, était un peintre méprisable, enchaîné, ne produisant quelques efforts qu’à force de courage et de volonté; eh bien! il n’avait plus qu’à f... le camp, qu’à refuser d’être avec ses anciens camarades, et seul, dans son coin, poursuivre sa tâche!
De tous côtés, du reste, on le lâchait. Duranty, le Duranty du café Guerbois le blaguait. Zola, lui-même, devenait plus distant. Il écartait peu à peu Cézanne qui, selon lui, «s’enlisait de plus en plus dans la folie de l’impuissance.»
Par contre, quelques nouveaux amateurs venaient à lui. Un nouveau marchand: Portier: de jeunes peintres lui offraient de fervents hommages. Van Gogh (que, pourtant, Cézanne n’estimait point), écrivait ici et là:
Extrait d’une lettre à son frère Théo (1888):
«Involontairement ce que j’ai vu de Cézanne me revient à la mémoire, parce que lui a tellement—comme dans la Moisson que nous avons vu chez Portier, donné le côté âpre de la Provence...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Il faut que j’arrive à la fermeté de couleur que j’ai dans cette toile, qui tue les autres. Lorsque j’y pense que Portier racontait que les Cézanne qu’il avait, avaient l’air de rien du tout, vus seuls, mais que rapprochés d’autres toiles, cela enfonçait les couleurs des autres. Et aussi, que les Cézanne faisaient bien dans l’or, ce qui suppose une gamme très montée...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«La nature près d’Aix où travaille Cézanne, c’est juste la même qu’ici, c’est toujours la Crau. Si en revenant avec ma toile, je me dis: «Tiens, voilà que je suis arrivé juste à des tons au père Cézanne», je veux seulement dire ceci que Cézanne étant absolument du pays même comme Zola, et le connaît donc si intimement, il faut qu’on fasse intérieurement le même calcul pour arriver à des tons pareils»...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autre extrait de lettre, envoyée de Saint-Rémy (1889).
«Car, oui, il faut sentir l’ensemble d’une contrée—n’est-ce pas là ce qui distingue un Cézanne d’autre chose?»
Van Gogh écrit maintenant à son ami Emile Bernard:
«Cézanne est justement homme marié, bourgeoisement, comme les vieux hollandais; s’il bande bien dans son œuvre, c’est que ça n’est pas un trop évaporé par la noce.»...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extrait d’une autre lettre:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Si tu voyais mes toiles, qu’en dirais-tu? Tu n’y trouverais pas le coup de brosse presque timide et consciencieux de Cézanne.
«Mais puisqu’actuellement je peins la même campagne de la Crau (Camargue)—quoiqu’à un endroit un peu divergent—toutefois il pourrait y demeurer certains rapports de couleur. Qu’en sais-je? Involontairement, j’ai de temps en temps pensé à Cézanne justement quand je me suis rendu compte de sa touche si malhabile dans certaines études—passe moi le mot malhabile—, vu qu’il a exécuté les dites études probablement lorsque le mistral soufflait. Ayant appris à la même difficulté, la moitié du temps, je m’explique la raison pourquoi la touche de Cézanne est tantôt très sûre et tantôt paraît maladroite. C’est son chevalet qui branle.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mais, malgré ces hommages, Cézanne eût voulu être reçu au Salon officiel, au salon de Bouguereau, comme il disait. Pour «épater Aix» et aussi pour «em.... Bouguereau» nous dit M. Vollard.
Refusé tout le temps; (la guillotine sèche, disait Cézanne), il eut tout de même le plaisir, en 1882, d’emm..... donc Bouguereau, en figurant au Salon officiel, avec un Portrait d’homme, grâce, il est vrai, à son ami Guillemet, qui, faisant partie du jury, imposa la toile de Cézanne comme étant l’œuvre d’un de ses élèves.
Et, en 1889, au Salon de l’Exposition Universelle, Cézanne est de nouveau accroché. Mais cette fois encore, c’est un ami qui est intervenu en sa faveur: M. Choquet.
Et ce peintre qu’on recevait avec, certes, le dégoût le plus manifeste, les rires les plus sarcastiques, avait peint, en en oubliant tant d’autres, ces toiles aujourd’hui illustres: L’Estaque; la Corbeille de pommes; le Jas de Bouffan; La Lutte; Gardanne; La Maison abandonnée; Etude de baigneuses; le grand Pin; le Mardi-Gras; la Forêt de Chantilly; les bords de la Marne; etc. etc.
En 1890, un nouvel hommage est accordé à Cézanne. Et cette fois, il lui vient de Belgique.
Il est invité à exposer à Bruxelles par une société d’artistes, les XX. Société de vingt artistes indépendants, novateurs, qui se réserve d’inviter à chacune de ses expositions annuelles vingt autres artistes déjà consacrés.
Cette société s’était formée en se séparant d’une première société, l’Essor, jugée trop académique. Les fondateurs se nommèrent James Ensor, Franz Charlet, Vogels, Willy Schlobach et Théo Van Rysselberghe.
Cette société ne devait durer que dix années (on estimait que, passé ce temps, la foi serait morte!) Les XX ne furent jamais vingt. On citait parmi les peintres: Théodore Verstraete, Guillaume Van Strydonck, Fernand Khnopff, James Ensor, Willy Finch, Jean Delvin, et, parmi les sculpteurs: Achille Chaînaye et Jef Lambeaux.
Le secrétaire fut Octave Maus, qui, à la fin de la Société (les dix ans écoulés), fonda, lui, la Libre Esthétique.
Cézanne répondit à l’invitation des XX en envoyant trois toiles: un Paysage; la Chaumière (de la collection Choquet), et les Baigneuses.
Cinq années encore, puis Cézanne va connaître la notoriété totale.
M. Vollard, en qui Pissarro a allumé un vif amour pour les tableaux de Cézanne, M. Vollard décide d’exposer dans sa galerie, rue Laffitte, au mois de décembre 1895, le plus de toiles de Cézanne qu’il pourra rassembler. Il arrive à près de 150 peintures. Elles viennent toutes de chez Cézanne.
En cette occurrence, Pissarro a été encore le plus précieux et le plus actif des truchements. Lui seul pouvait vaincre les hésitations, les craintes, les dégoûts de Cézanne.
Il faut relire dans le livre de M. Vollard l’historique des scènes qui se déroulèrent autour de cette exposition mémorable. Certes, M. Vollard, emporté par sa bonne humeur et par son ironie, a chargé son récit. Il l’a picraté de plaisanteries et d’humour. Mais ne croyez-vous pas que d’autres visions de scènes très comiques ou que des manifestations de fureur sauvage soient restées inédites? Il n’y a aucun doute: en exposant ces toiles illustres, M. Vollard portait un défi au bon sens, à la saine raison, au bon goût, enfin aux plus nobles traditions de l’Académisme. Il violentait les Vierges, il outrageait les Mères, il traînait par les cheveux les Représentants les plus célèbres du Barreau, de la Magistrature et de la Collection. C’était un défi à l’opinion publique, une invraisemblable gageure, quelque chose comme un crime contre la Société. Et elle le lui fit bien voir, la Société, que ce n’était point en vain qu’on se moquait d’elle, qu’on l’outrageait. M. Vollard connut toutes les meilleures blagues de la Rue; Bourgeois et Bourgeoises l’invectivèrent, l’apostrophèrent; un vigilant commissaire de police, défenseur de l’ordre, s’en mêla—et mit au violon, je veux dire dans l’ombre la plus noire: La Léda au cygne, et la Baigneuse devant la tente!
Pouvait-on se moquer ainsi du public? Ces femmes, peintes par Cézanne, des horreurs! Ses portraits, le sien particulièrement, quelle honte! Un jour, à la bonne heure, on avait pu lire ce commentaire sous une toile de Manet, passée en vente: Manet à la palette: «Manet s’est très peu peint lui-même, au contraire de certains artistes, tels que Rembrandt et Cézanne, qui ont multiplié les portraits d’eux-mêmes. Rembrandt et Cézanne n’étaient pourtant pas précisément ce que l’on pourrait appeler de «jolis hommes» (sic), tandis que Manet avait un physique «très agréable» (re-sic)».
Oui, lui, Cézanne, c’était un homme des bois! un homme qui paraissait affligé d’une saleté constitutionnelle; quelque chose, répétait on, comme le Saint Labre de la Peinture. Et encore cet homme sauvage se permettait-il de détester les femmes et de les appeler des veaux. Aucune certes n’eût voulu poser pour lui; et l’on se répétait qu’il en était réduit à peindre ses Baigneuses d’après des dessins exécutés autrefois à l’Académie Suisse ou d’après des images du Magasin Pittoresque.
Dans toutes ces conditions, l’exposition des œuvres de Cézanne fut, on le peut croire, un événement dans la rue Laffitte—et aussi dans le Monde. C’est l’insigne honneur de M. Vollard d’avoir assumé la responsabilité de cette rude bataille, et de l’avoir fait gagner par Cézanne malgré les sarcasmes, les cris, les injures, les violences, les rires et les quolibets. Sans doute, les camarades de Cézanne, Renoir, Pissarro, Monet, Sisley allaient devenir, eux aussi, avec des fortunes diverses, des peintres réputés, honorés; mais Cézanne sortit de là le plus haut de tous ces peintres, le plus original, le plus étrange et le plus rare d’entre les plus rares.

MAISONS AU TOURNANT D’UN CHEMIN
(Collection Auguste Pellerin)
Je reviens à ce Jas de Bouffan qui fut, pendant de longues années, un lieu de paisible retraite pour Cézanne. J’ai parlé du petit atelier qu’il avait installé au second étage de la maison d’habitation; mais souvent aussi il travaillait dans la grande salle du rez-de-chaussée, où, sur les murs, il représenta les tableaux que j’ai déjà mentionnés. Les entours, très vastes, je veux dire le jardin, la serre, toutes les dépendances de la maison d’habitation composèrent également autant de motifs.
Même il faisait poser ses fermiers; et pendant une dizaine d’années, l’un d’eux, paysan jardinier, le sieur Paulet, lui servit de modèle. J’ai vu M. Paulet alors retiré au Puy-Sainte-Reparade. Il figure dans maints tableaux, entre autres, dans celui des deux Joueurs de cartes, l’homme à la pipe aux dents.
Entre temps, quelques événements étaient survenus dans la famille de Cézanne et pour lui-même.
En l’année 1886, au mois d’octobre, son père était mort, laissant la propriété du Jas de Bouffan et une fortune de 1.600.000 francs. En 1881, il avait marié sa seconde fille, Rose, avec M. Maxime Conil, rentier à Aix; et à celui-ci, apportant la bague de fiançailles, tout Aix se souvient encore qu’il avait dit en riant: «Oi! si donno uno baguo oro! Jeou! quan mé sicou marrida, avion dous penden: Paul—mouvement à droite—einé Marie!—mouvement à gauche—(Comment vous donnez une bague en or! Moi, quand je me suis marié, j’avais deux pendants: Paul et Marie!)»
Lui, Paul Cézanne, avait épousé, à Aix, Mlle Marie-Hortense Fiquet, originaire du Jura. Les témoins de la mariée furent MM. Louis Barré et Jules Peyron, de Gardanne; ceux du marié: MM. Jules Richard et Maxime Conil. La cérémonie s’accomplit dans la plus stricte intimité; et, le lendemain, dès la première heure, dans l’église Saint-Jean-Baptiste (extra muros), l’abbé Bicheron conclut le mariage; les deux mariés, M. Maxime Conil et Mlle Marie Cézanne étaient seuls présents.
En 1897, Cézanne perdit sa mère. Il n’avait jamais cessé d’entourer de la plus chaude affection celle qui, de son côté, l’avait toujours soutenu. Il suivit, accablé, le convoi, entre son fils et son beau-frère, M. Maxime Conil; et, durant des mois, il ne travailla point. Sa mère morte, même il ne voulut plus aller au Jas de Bouffan; de sorte que la vente de cette propriété fut décidée. Et, en décembre 1899, elle fut adjugée pour 75.000 francs à M. Louis Granel.
Ce dernier, ingénieur agronome, parisien, modifia singulièrement la maison d’habitation, jusqu’au jardin, jusqu’à la serre, jusqu’à l’entrée sur la route.
Il ne faut pas, en somme, se figurer l’état actuel du Jas de Bouffan comme étant celui au temps où ce domaine appartenait à la famille Cézanne.
Toutes les rampes en fer forgé, toutes les colonnes, toutes les statues, tous les balcons, jusqu’au cadran solaire, jusqu’à l’ours en pierre et autres sphinx, tout cela fut installé par M. Granel, qui fit bientôt du Jas de Bouffan un véritable musée. Le petit bassin, derrière la maison, où Cézanne avait coutume de laver ses brosses et ses pinceaux, vous le voyez maintenant orné d’une colonne avec un vase votif,—et il y eut ainsi des changements pour à peu près tout.
Quand M. Granel (aujourd’hui décédé) prit possession du domaine, il trouva sur les murs toutes les peintures exécutées par Cézanne et délaissées par lui. Dans le petit atelier, là-haut, des toiles, des dessins gisaient aussi pêle-mêle; et, ne sachant pas—un ingénieur!—M. Granel ordonna de tout détruire. On sauva seulement les châssis, parce que c’était du bois! Alors que le plus débile peintre attache une exceptionnelle valeur au moindre de ses ratés, Cézanne, lui, ne se souciant de rien, avait laissé à l’abandon le patient travail de plusieurs années. Des fétichistes—je veux dire des marchands.... attentifs ont arraché depuis aux murs—et vendent maintenant ce que Cézanne avait dédaigné!
A l’Estaque, ce faubourg de Marseille, Cézanne vécut aussi de longs mois. Il y allait retrouver sa mère, qui possédait une villa près de l’église. Si, par hasard, il y était seul, c’était la femme d’un pêcheur, la Cadette, qui lui préparait sa cuisine. Il tenait à cette servante, parce qu’elle était impitoyablement sourde—et ne lui parlait que par signes. Il n’aimait point qu’on lui adressât brusquement la parole. Il n’aimait point, comme il disait, qu’«on lui mît le grappin dessus». Il n’était apaisé que lorsqu’il était seul.—Aix, Paris, tout d’un coup, tout le rebutait. A ces moments-là, l’Estaque offrait alors pour lui aspect de site pacifiant.
L’Estaque! Des tuiles rouges, des hautes cheminées, des bateaux, des terres rouges et la Méditerranée, si bleue, ou si verte, sous la légèreté limpide des beaux ciels de là-bas!
Ils passent les remorqueurs, les voiliers; elles glissent les petites barques à la voile latine, par vent de brise. La vague pilonne le roc avec le coup sourd du bélier; et, à la crête des vagues, des mouchetures blanches se poursuivent sans se rattraper et sans trève.
Cézanne aimait cette réunion de vifs estaminets à coquillages, de petits cabanons tout secoués de rires et de cris. Puis c’était un concert; une villa moresque dans les pins; des palmiers et des mimosas.
Pourtant quelles couleurs criardes, quels verts aigres, quels jaunes serins et bleus d’azur! Et tous ces gens, le dimanche, en famille, étalés en manches de chemise au bord de la mer! Paquets de dîneurs, comme de lourdes grappes de moules, accrochés après les rochers, bâfrant et grouillant;—et, dans tout ça, des odeurs, des excréments séchés, de la poussière, de l’ail et de la chaleur, jusqu’à la tombée du crépuscule, moment où les crapauds, vieillards moroses, grognent et grondent.
Rappelez-vous aussi les souples platanes du Midi et les jeunes pins, déhanchés et valseurs, les jeunes pins qui brandissent des contorsions et des bonds en avant et des bonds en arrière de chèvre-pieds. Et les hauts palmiers toujours verts; et les mûriers du Japon, quel enchantement!
Pour Cézanne, l’Estaque était bien tout le bout du monde. Il n’avait jamais voulu vraiment voyager. En lui, rien du globe-trotter. Plus tard, on le verra même se fixer à Aix, se contenter des seuls admirables paysages aixois; et attendre sa fin en peignant parfois aussi des natures mortes; sans se dire aucunement qu’il y a des Jeux en Grèce que déshonore M. Gérôme—et des «turqueries» qu’«évacue» M. Ziem.
On a vu que la personnalité de Cézanne, aux premières expositions des Impressionnistes, avait jeté sur lui le gros des rieurs et des plaisantins. Mais une minorité, une élite avait, en même temps, offert au peintre le plus honni une précieuse compensation.
Dès l’exposition de 1874, Cézanne, à ses plus anciens amateurs et défenseurs: le docteur Gachet et M. Théodore Duret,—avait ajouté le comte Doria, qui fut le premier possesseur de la Maison du Pendu, paysage peint à Auvers-sur-Oise, et aujourd’hui entré au Musée du Louvre grâce au legs de la Collection Camondo.
En même temps, Cézanne avait acquis toute la ferveur d’un autre amateur nommé Choquet.
M. Choquet était un collectionneur, sans très imposantes ressources, qui, parti de Delacroix, dont il possédait plusieurs œuvres, était arrivé tout droit aux Impressionnistes, parmi lesquels il élut tout de suite Cézanne, dont il devait être durant toute sa vie l’enthousiaste et persuasif héraut.
Lié bientôt avec Cézanne, il ne cessa jamais de lui acheter des toiles;—et il lui fit peindre à plusieurs reprises son portrait, tantôt à la ville, tantôt dans une petite maison qu’il possédait aux champs. Ce fut ainsi qu’en juillet 1899, à la vente après décès de Madame Choquet, qui avait hérité de la collection de son mari, trente et une toiles de Cézanne passèrent aux enchères. Dans le nombre, se trouvait cette toile maîtresse: Le Mardi-Gras.
M. Théodore Duret collectionna aussi de nombreuses toiles de Cézanne, à dater des premières payées quarante francs l’une dans l’autre et représentant des paysages d’Auvers-sur-Oise. Quand M. Théodore Duret fut contraint de faire une première vente, en mars 1894, des toiles de Cézanne figurèrent parmi des œuvres de Manet, de Degas, de Pissarro, de Sisley, de Monet, de Guillaumin, de Berthe Morisot et de Renoir.
En mars 1894! C’est-à-dire au moins vingt ans trop tôt.
Du reste, c’est bien simple, nombreux se comptèrent les amis avertis qui prièrent M. Théodore Duret d’enlever les toiles de Cézanne, pour ne pas disqualifier la vente qu’il allait réaliser dans la Galerie Georges Petit.
Bien entendu, M. Théodore Duret resta sourd à ces chaudes supplications; et la vente eut lieu, avec tous ses numéros. Je dois dire qu’une vague de stupeur submergea et ahurit les assistants quand, à propos de la Route dans un Village, de Cézanne, ils entendirent le commissaire-priseur s’écrier: «Huit cents francs! Adjugé à M. Claude Monet!» Telle avait été la volonté de l’acheteur.
A la vente Choquet, il est vrai, mais cinq ans plus tard!—les amateurs ont éclairé leur lanterne. Ils ont le pressentiment—fouaillés par des écrits, par le bruit de l’exposition Vollard, par d’enthousiastes propos de vieux et de jeunes peintres,—ils ont le pressentiment que les Cézanne «monteront»; et ils élèvent maintenant leurs enchères, avec, toutefois, dans le dos, le frisson de la «petite mort!»
Voici quelques prix: En sortant d’Auvers (1.000 francs); Le petit pont (2.200); un dessert (3.500); Fleurs dans un vase (2.000); Les petites maisons d’Auvers (1.500); Pommes et gâteaux (2.000); le Mardi-Gras (4.400), etc.
Parmi les peintres, Claude Monet, Pissarro estimaient ouvertement Cézanne. Caillebotte vint se joindre à eux. Ce fut cet excellent peintre qui, entre autres tableaux de ses amis les Impressionnistes, posséda, avec d’autres toiles de Cézanne, le grand tableau des Baigneuses.
A sa mort, il légua en totalité sa collection au triste Musée du Luxembourg. Mais alors, en cette année 1895, ce fut un vif hourvari parmi les ganaches de l’Ecole des Beaux-Arts et de l’Institut, M. Bonnat, en tête. La collection fut épluchée avec dégoût, et la Direction des Beaux-Arts, en plein accord avec les cuistres de la Société des Amis du Musée du Luxembourg, refusa vingt-cinq toiles du legs. Bien entendu, Cézanne surtout fut malmené. Les Baigneuses et deux autres tableaux: Un Bouquet de fleurs et une Scène champêtre furent rejetés avec la plus savoureuse hilarité.
Tout cela ne fut sans doute point pour déplaire aux anciens amis de Cézanne, qui l’avaient renié. L’ancien camarade d’Aix, le «fidèle» ami des premières années de Paris, Emile Zola, éclata, très satisfait de voir que sa clairvoyance n’avait pas été longtemps en défaut. Son roman: L’Œuvre, avait mis en effet en scène ces deux ratés, ces deux amis de jeunesse à Aix-en-Provence: le peintre Claude Lantier (Paul Cézanne) et le sculpteur Mahoudeau (Philippe Solari).
Je me souviens que lorsque parut l’Œuvre, ma première idée fut d’écrire à Zola pour lui demander les véritables noms des personnages de ce roman. Il voulut bien répondre au collégien que j’étais une courte lettre, dont j’ai seulement retenu ces mots essentiels: «Et puis à quoi bon vous citer des noms? Ce sont ceux de vaincus que vous ne connaissez point sans doute.»
Cette lettre, elle existe peut-être encore. Mais, jeune, on ne collectionne pas les autographes. Je ne puis que jurer qu’elle me fut adressée.
Plus tard, après avoir admiré l’œuvre de Cézanne, je demandai un jour à Huysmans ce qu’il pensait de Zola critique d’art.
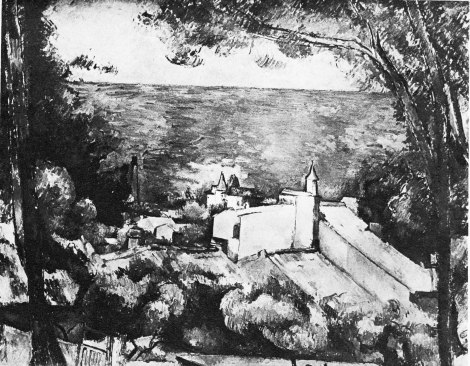
L’ESTAQUE
(Collection Auguste Pellerin)
«Lui! me jeta-t-il, c’est un gros bêta de la brocante. Evidemment, vers 1883, dans mon livre l’Art Moderne, disciple encore de ce romancier, dont je ne nie point, entendez-le bien, la puissance, j’ai pu, par faiblesse, lui accorder quelque compétence artistique. Mais, depuis, j’en suis bien revenu. Qui a-t-il découvert? Qui a-t-il loué? Manet! Mais il y a belle lurette que Manet bataillait quand Zola a parlé de lui. Ah! ça, je reconnais que Zola a pu, à un moment précis, donner le change; car avec les médiocres pions qui fourrageaient alors chez les peintres, on n’allait pas loin. Oui, c’était le temps où ce sénile Albert Wolff caracolait! Mais l’incompétence de Zola en art est totale. Il est là dedans plus fermé, plus buté qu’un normalien; et ce n’est pas peu dire! Mais voilà, il fallait qu’il touchât à tout!»
«Allez, du reste, chez Zola, vous serez mieux encore renseigné sur Cézanne!»
Et j’y allai.
Zola était accueillant, courtois; et enfin c’était le haut romancier de l’Assommoir et de Germinal. Avec quel respect, je me pris à l’écouter. Et, tout de suite, après un court préambule: «Ah, oui, Cézanne, quels regrets pour moi de n’avoir pu le pousser! me dit-il. Et j’ai tracé d’après lui, dans mon Claude Lantier, un portrait encore atténué, car si j’avais voulu tout dire!»
Et Zola soupirait. Moi, pendant ce temps, mes yeux allaient du vitrail Coupeau aux objets d’art vidés là par tous les brocanteurs de Paris. L’Hôtel du Maître en était rempli. Ce n’était pas un choix très sûr. Mais Zola continuait:
«Ah! mon cher Cézanne ne tient pas assez en outre à la considération publique. Il méprise trop les choses les plus élémentaires: hygiène, bonne tenue, mots choisis. Et encore tout cela, la bonne tenue, le respect de soi-même, peu de chose, en somme, si mon grand et cher Cézanne avait eu du génie. Croyez-bien qu’il m’en a coûté d’être obligé de l’abandonner!... Oui, partir à deux dans la même foi, dans le même enthousiasme, et arriver seul, atteindre seul la gloire, c’est une lourde douleur qui vous accable! Pourtant, il me semble, malgré tout, que, dans l’Œuvre, j’ai noté avec le plus attentif scrupule tous les efforts de mon cher Cézanne. Mais, que voulez-vous? c’étaient des défaillances successives; des bons départs, puis tout d’un coup des arrêts brusques; un cerveau qui ne pensait plus, une main qui retombait, impuissante. Jamais une chose conduite jusqu’au bout, avec une ténacité et une force magnifique. En somme, aucune réalisation!»
Le mot était lâché! «Cézanne ne réalisait pas!» Cézanne lui-même, d’ailleurs, répétait ce mot. Il y tenait. Le fameux mot devait devenir le mot de ralliement de toute la foule dressée contre le peintre. Des ébauches, oui; des essais, des tentatives, des embryons, des avortements, tout ce qu’on voudra; mais des œuvres, mais des choses venues à terme, puis ensuite finies, fignolées, ah! Dieu, non!
«La considération publique?» m’avait dit Zola. Et ce mot, il l’avait prononcé avec une sorte d’emphase.
Hélas! si, à Aix, le père de Zola, François Zola, ingénieur attaché aux travaux du barrage, était considéré,—lui, Emile Zola, qui tenait tant à la considération publique, on le méprisait dès le collège Bourbon; et, plus tard, son buste par Solari (Mahoudeau, de l’Œuvre, ô ironie!) ne le recouvrit-on pas d’excréments, dans la nuit qui suivit l’inauguration de ce buste, en retrait de la toute petite place Ganay, à Aix?...
Considération publique, considération officielle, ce fut tout comme! et Cézanne ne devait obtenir ni l’une ni l’autre.
Et Octave Mirbeau s’en rendit compte quand, en 1902, cédant avec un peu d’irritation à un désir de Cézanne, qui eût été satisfait d’obtenir la croix (oui, la considération officielle tout de même, et puis Aix!, enfin une de ces faiblesses que beaucoup d’entre les meilleurs ont subies), il s’en fut trouver le Directeur des Beaux-Arts, le nommé Henry Roujon, qui suivait avec une imperturbable assurance la leçon de ses prédécesseurs, c’est-à-dire culte à plat ventre devant le banal, le poncif, le vide et mépris pour le talent inédit et l’originalité entière.
Aux premiers mots de Mirbeau, Roujon sursauta:
—Mais, mon cher Mirbeau, demandez-moi la croix pour n’importe qui; pour n’importe quoi; mais pour cet anarchiste, pour ce fou de Cézanne, vous n’y pensez pas! Oui, vous voulez rire! c’est une farce, allons! Ah! oui, oui, c’est une farce!—Et Roujon ricanait.—Ah! oui, je comprends maintenant! Elle est bonne! Elle est bien bonne! Ah! ce sacré Mirbeau, toujours jovial, toujours pince—sans rire! Çà, mon bon, je la raconterai votre visite; oui, je m’en tiens les côtes!—Et Roujon éclatait.—Non! vrai, c’est comique, tout à fait comique! Et j’ai marché comme un daim, oui, mon bon, comme un vrai daim! Aussi, tenez, je la couronne, cette farce!—
Et Roujon, s’emparant d’un buste en plâtre calé sur son bureau, se coiffa, toujours hilare, du buste de Minerve!
Somme toute, il faut bien le dire, Cézanne s’était lourdement ennuyé pendant tous ses séjours à Paris. Aux anciens amis ou plus simplement à ses camarades, il n’avait plus rien à dire. Il s’était encore plus détourné d’eux qu’ils ne se détournaient de lui. C’est sans regret qu’il songeait au jour prochain qu’il ne les reverrait plus. Les peintres plus jeunes ne l’intéressaient point davantage. Il était allé souvent au musée du Louvre; il savait à quoi s’en tenir maintenant sur les peintres représentés là, au hasard; des photographies, des gravures au besoin fixeraient d’ailleurs ses souvenirs. Enfin, il était malade.
Atteint du diabète, il devenait chaque jour plus hargneux, plus hypocondriaque. Il ne pouvait plus supporter une discussion; et les peintres, particulièrement, avec leurs idées courtes, le rebutaient. Dans ces conditions, il n’y avait vraiment plus qu’à se souhaiter un vrai havre de grâce, un asile loin des gêneurs. Et Aix, où il était certain de rejoindre une sœur dévouée, restée vieille fille et fort entendue à la vie, lui apparut comme le parfait lieu de repos qu’il pouvait désirer.
A Aix, il se réinstalla donc rue Boulegon, dans cette étroite rue, très provinciale, où son père autrefois avait eu sa banque. Au second étage, Cézanne retrouvait aussi son atelier. Sans doute, combien de fois s’y était-il irrité, parce que, de l’autre côté de la rue, une haute cheminée en briques lui envoyait des reflets rouges? Combien de toiles avait-il crevées là en recommandant à sa gouvernante, Mme Brémond, de «tout brûler» pendant qu’il serait sorti! N’importe! Là, au moins, on «lui foutrait la paix!» Tous ces Parisiens, avec leur Bouguereau, avec leur blague, il ne les verrait plus, jamais, jamais! Et si les peintres de l’ancien café Guerbois l’avaient bien dégoûté, ce Manet, ce Degas, ce Renoir, il n’avait pas plus de tendres souvenirs pour le vaniteux Zola, pour la vieille fille Goncourt et pour le léger plaisantin Daudet. Ce dernier, à un déjeuner de Provençaux, n’avait-il pas raillé Cézanne, qui, du reste, regimba très bien! En somme, le père Gachet, M. Théodore Duret, Pissarro et Choquet, c’était là «ce qu’il avait connu de mieux!» et tous les autres, c’était bien à piler dans le même panier, avec Bouguereau par dessus!
A Aix, tout de suite, Cézanne se confia entièrement à sa sœur, Mlle Marie Cézanne, et à sa gouvernante, Mme Brémond. Et, très vite, il se réjouit de sa détermination.
Car, il le répéta maintes fois les premiers temps, le monde, le boulevard, l’esprit parisien, tout cela l’avait terrifié,—comme le souci d’être vêtu à peu près proprement l’avait indigné. Cela datait de longtemps que les gens «bien mis» l’exaspéraient; et puis enfin qu’est-ce que Paris lui avait procuré en somme? Les théâtres? il n’y avait jamais mis les pieds; ces industries-là lui faisaient horreur. Les salons de peinture? Un amas de prétentieuses nullités, un cloaque de mauvaises huiles, une honte, enfin! Les hommes politiques? Çà, il pouvait se vanter de ne connaître aucun de ces malfaiteurs ou de ces niais! Alors, imbéciles pour imbéciles, les Aixois ne dépassant pas les Parisiens, autant retourner dans son coin, maintenant qu’il avait vu qu’on ne peignait pas mieux à Paris qu’ailleurs!
Je sais bien qu’à Aix Cézanne donnera le spectacle, que tout le monde alors peut voir, d’un vieillard qui «se laisse aller», et qui «n’a aucun souci de l’opinion publique». Les Aixois même encore aujourd’hui vous disent volontiers: «Cézanne! Il avait le regard en dedans; c’était un bonhomme singulier. Il «ne fréquentait pas!» Il portait la moustache sale, et le bouc mal tenu. Et il était chauve. Et puis, ceci encore, il avait le nez violet et des yeux rouges qui pleuraient tout le temps!»
Et ils ajoutent avec non moins d’entrain:
«Et habillé! A croire qu’il était un pauvre de la ville, alors qu’il était tout de même le fils du banquier Cézanne. Toujours crasseux, une cravate devenue ficelle, une houppelande, l’hiver, de colporteur, et des gros souliers de roulier; voilà le beau peintre que Paris avait renvoyé à Aix!»
Soit! Aix le reçut et le garda.
Levé tôt, il partait, quand il n’allait pas au motif, pour son atelier du chemin des Lauves (Lauve, pierre plate, espèce de marne).
Toute une histoire vraiment, la construction de cet atelier en pleins champs et jardins, édifié près du canal du Verdon, et dans le haut de la ville.
Cézanne, en se promenant sur le chemin de la Violette, qui est près de l’Hôpital, avait, un jour, au bord du chemin des Lauves (qui conduit au hameau de Puy-Ricard), découvert une cabane et un terrain à vendre: 5.000 francs.
C’était assez loin d’Aix. Là, on le laisserait en paix. Cézanne acheta la cabane et le terrain.
Puis un architecte, nommé Mourgues, reçut mission de raser la cabane et de construire un rez-de-chaussée avec, par dessus, un atelier de huit mètres sur cinq.
Comme tous les architectes se ressemblent, le sieur Mourgues se lança dans la construction d’une villa hurluberlue, avec toit découpé et balcon de bois, enfin tout le falbala de la céramique et du bois verni. Cézanne laissait faire. Mais quand le chef-d’œuvre fut terminé et qu’il le vint voir, sa fureur éclata. Avec une telle impétuosité, qu’il fallut démolir et construire simplement une bastide provençale, avec corniche à la gênoise, et entourée d’oliviers et de figuiers. Coût: 30.000 francs.
Alors une autre comédie commença.
Rue Boulegon, j’ai déjà noté que Cézanne s’était plaint des reflets rouges d’une cheminée voisine. Voici qu’à l’atelier du chemin des Lauves, il tombe sur des reflets verts, projetés par les oliviers et les figuiers! A son ami, M. Rougier, serrurier d’art (à qui l’on doit maintes belles œuvres dans toute la Provence), et qui l’accompagne ce jour-là, il montre ses mains: «Vous voyez! s’écrie-t-il. Là! ces reflets verts!» et, tout de suite, il enrage, il se traite d’imbécile et parle de repartir pour Paris. On le calme enfin, en lui disant qu’on enlèvera les arbres.
Dans cet atelier, chaque fois que le temps sera inclément Cézanne, désormais, viendra travailler. Et, comme partout, il encombrera bientôt cet atelier de photographies, de couleurs, de cartons, de feuilles à dessin, de fruits qui se dessècheront ou pourriront, de fleurs qui se faneront, d’étoffes dont le tas grossira de jour en jour.
Il y aura partout des œuvres commencées, des aquarelles qui infligeront de redoutables hernies à de pacifiques cartons; et, sans répit, Cézanne aggravera ce désordre de choses, ne permettant à personne, d’ailleurs, d’y apporter un changement.
Par un jour de novembre de l’année 1914, j’ai voulu revoir cet ancien atelier de Cézanne. Logis maintenant clos et abandonné. De longanimes et lourds R. A. T. vinrent me dévisager, puis ils repartirent. Toujours la patriotique flamme de ce terrible Midi!

LES POIRES ET LE SUCRIER BLANC
Du chemin des Lauves, près de l’atelier de Cézanne, Aix luisait sous un ciel bleu et chaud,—on eût dit d’été. Des toits, des pins et des arbres rouillés. On voyait, construit à la manière de Cézanne, tout un ensemble: la tour de la Cathédrale, le clocher de Saint-Jean de Malte; puis, des envols de fumées, la montagne de Notre-Dame des Anges, le Mont-Aiguet, et les collines de Septèmes et celles de Simiane et de Gardanne.
Tout cela chantait, comme un beau paysage, dans l’or des platanes, dans le vert lourd des sapins. Aix était descendu de la Montagne, vers la rivière Arc. Au temps de Marius, Aix se tenait là-haut, nid d’aigles qui saignèrent les Teutons dans la plaine de la Montagne virginale, la Sainte-Victoire.
Puis j’ai considéré encore la bastide de Cézanne. Les volets gris étaient clos; le crépi était jaune sale. Les tuiles avaient une couleur d’ocre rouge; et la large baie de l’atelier gardait toujours son grillage, utile défense contre les pierres des gamins aixois.
Dans le jardin qui descend jusqu’au canal, il y a des oliviers, des amandiers, des ronces, des pommiers et des cerisiers qui poussent maintenant à l’abandon. Je regarde plus attentivement la porte d’entrée, une porte charretière; c’est par là que passait Cézanne, un haut peintre que l’on disait déséquilibré, et qui avait l’air, en effet, d’un de ces vieux vagabonds que rejettent les maisons centrales, aux approches de l’été.
Quand venaient les beaux jours, Cézanne, tel un chemineau, allait aussi sur les routes, ivre d’air et de lumière.
Il partait alors pour le «motif», soit à pied, soit en voiture. Tant qu’il put marcher, il préféra s’en aller, tout seul, chargé du chevalet, du parasol, des toiles et de la besace, la biasse, comme ils disent, les Provençaux.
Il s’en allait alors au Tholonet, à Bibemus, à Meyreuil, à Saint-Antonin, ou sur les bords de l’Arc. Il avait aussi beaucoup aimé les Pinchinats, mais de beaux arbres y ayant été coupés, il n’y retourna plus.
Il loua le Château-Noir, sur la route du Tholonet. Cette bâtisse lui servit alors de remise pour ses toiles et son fardeau. Quand il travaillait ainsi dehors, il se fatiguait tellement qu’à peine rentré chez lui, il se couchait.
Au travail, il devenait de plus en plus irritable. On a souvent répété qu’il disait: «Je ne veux pas qu’on me mette le grappin dessus!» Rien n’est plus exact. Cela voulait dire qu’il avait peur des hommes. Au motif, un passant s’approchait-il, il s’écriait, furieux: «C’est un rustre! encore un qui n’y connaît rien!» et, le passant parti, Cézanne, hors de lui, ajoutait: «C’est un c...!»
Et il peignait de plus en plus malproprement. Et avec des pinceaux dans quel état! et pourtant il les nettoyait. Il raclait, il reprenait, avec quelle fatigue et quel acharnement! Des amas de couleur tombaient à ses pieds, bariolaient le sol. Il y en avait sur ses vêtements, sur son visage, partout! Nul ne manipula jamais davantage les couleurs pour plus de beauté!
C’était presque toujours le même cocher, Fernand Bajole, qui le conduisait «prendre ses quartiers» aux coins que j’ai déjà nommés, et à Beaureceuil, à Silvacane et au Pont des Trois-Sautets. Mais plus souvent encore au pied de la montagne Sainte Victoire, alpille illustre, d’où, en l’an 102 avant J. C. «des feux allumés à la cime azurée de cette belle masse calcaire et marmoréenne annoncèrent bien loin le triomphe des Romains sur la Barbarie!»
Sa montagne Sainte-Victoire! «Là, disait Cézanne, je suis bien, je vois clair; il y a de l’air!»
La Sainte-Victoire! Elle est, en effet un divin mur de clarté. Elle retient de la lumière et de la chaleur. Elle rayonne, non pas éclatante, mais comme poreuse, gorgée de soleil. Regardez-la longtemps, et vous comprendrez l’enchantement de Cézanne devant cette majestueuse pierre ponce.
Autour d’elle, les terres rouges et les tendres arbres abondent. Quand on aime Cézanne, on a envie de crier devant ce miracle lumineux, coloré, contrasté, qu’il a si parfaitement renouvelé. Et, avec tant de continuité, souvenez-vous. «La Nature, répétait-il, c’est un jeu de patience. Il faut mettre chaque chose, chaque ton à sa place. C’est une boîte de pains à cacheter. Il en faut jouer avec persévérance, les bien accorder tous pour les faire valoir, chanter!» Et, pour ne pas être pris au dépourvu par les moyens matériels de son «métier», il prenait toujours ses toiles chez la veuve Tacussel, place Saint-Honoré,—et ses châssis chez Gabet, menuisier, établi dans une impasse de la rue Boulegon. «—Mais, enfin, il fallait qu’il fît pourtant partie de la Société des amis des Arts d’Aix!» pensa un jour un des jeunes amis de Cézanne, M. Jouven, un photographe artiste qui avait alors ses ateliers un peu en dehors de la ville, au Boulevard de l’Armée. Et il décide Cézanne à offrir une toile à la Société en question—et à assister au premier banquet qu’elle organisera.
Cézanne se laisse faire. Sa toile, on l’a mise au-dessus d’une porte; personne ne la peut voir. Au banquet, il y assiste, d’abord tranquille. Mais, au dessert, le président se met à prôner l’éducation dite classique, et il encense Bouguereau, chef vénéré des Salons officiels. Cézanne, bon Dieu! se lève d’un coup; et, tapant du poing sur la table, renversant des bouteilles, il s’écrie: «Il n’y a que Delacroix et Courbet! Vous êtes tous des c...!» Et la porte claque. Le lendemain, il dit à Jouven: «Ça y est! j’ai encore fait des bêtises, je me suis emballé! Mais, tout de même, ce sont tous des j.-f... vos amis des Arts!»
Bon homme, d’ailleurs; ou, plutôt insouciant de tous les Aixois. Il ne dénigrait jamais personne. Il répétait, à propos de n’importe qui: «Il est gentil, hein?» d’une parole très lente. Mais si on l’agaçait, il dépassait tout. A cette question posée par un bourgeois: «Avec quoi faites-vous vos fonds?» il répondit: «Avec de la m...!»
Un de ses amis préférés, c’était un libraire d’Aix, M. Dragon, établi place des Prêcheurs. Il allait souvent causer avec cet homme averti, nourri de substantielles lectures et dont les savants propos le récréaient. Il lui répétait: «A Paris, ils exagèrent! Je ne suis pas le grand peintre qu’ils disent. Tenez, Monsieur Dragon, les Parisiens sont des imbéciles, et je me suis toujours em... à Paris. Il n’y a pas moyen d’y travailler avec tous les bruits qu’on y entend, et avec tous les gens qui viennent vous déranger; et puis, ils font toujours de l’esprit, et pour moi, Monsieur Dragon, l’esprit, c’est de la m...! A Paris, il n’y a que le Louvre; mais ils ont f... l’Enterrement à Ornans dans un dépotoir!»
Un autre ami recherché était M. Rougier, le serrurier d’art que j’ai déjà cité, M. Rougier, son voisin de la rue Boulegon. Cézanne souvent l’arrêtait en pleine rue, et il lui formulait alors à terrible voix des théories picturales. Les passants, interloqués, s’arrêtaient, attendant une dispute. «Tenez, Monsieur Rougier, disait Cézanne. Vous voyez cet homme là, devant nous (il montrait un passant), eh bien! c’est un cylindre, ses bras ne comptent pas! Villars de Honnecourt, du reste, un ancêtre, a déjà, au treizième siècle, enfermé des personnages dans des armatures géométriques!» Et il continuait de crier.
D’ailleurs, toutes les discussions artistiques de Cézanne étaient impétueuses. Un de ceux qui essuyèrent aussi le feu de ses paroles, ce fut son vieux camarade aixois, le sculpteur Philippe Solari.
Ce Solari! Un bonhomme de petite taille, portant des moustaches à la gauloise, et qui vivotait très médiocrement.
Sculpteur sans originalité, il prit part au concours pour un monument à Puget, à édifier à Marseille. Il n’obtint que le second prix. Il se rattrapa en modelant une «République», que les Aixois déclarent d’une «fort belle allure».
Mais tout cela n’avait point doré l’existence de Solari, qui tenait son atelier à Aix, rue du Louvre, dans les communs, une grange à vrai dire, de l’ancien hôtel de Lubières. Ce fut là que (sans rancune contre l’éreintement de l’Œuvre), il convia à déjeuner Mme Zola, venue à Aix pour l’inauguration du buste de son mari. Il la traita en lui offrant des conserves sur une table branlante.
Ce petit homme, resté incurablement bohême, né—et mort à Aix, il y quelques années—, trouvait, le plus naturellement du monde, tous les repas à lui offerts excellents. Aussi Cézanne ne l’invitait-il jamais en vain.
Excellent convive donc, ce Solari; mais aussi quel joyeux prodigue!
Recevait-il par hasard une somme de cent francs, vite—si c’était le moment—il prenait un permis de chasse, et, pendant huit jours, on ne le voyait plus. Ou, encore, il empruntait des costumes au théâtre, et il modelait des statuettes représentant François Ier, Agnès Sorel, le cardinal de Richelieu ou Marie Stuart, qu’il ne vendait, bien entendu, point!
Il se consolait de cela en tenant férocement à ses chères habitudes.
L’une d’elles consistait à aller tous les matins «se vidanger» chez un de ses amis, logé à quelque distance de son atelier. La promenade facilitait, disait-il, l’opération. C’est, du reste, une coutume provençale, à bien dire: on va «cagar» en dehors de chez soi, dans sa propre bastide ou dans celle de ses amis: cette dernière pratique que suivait Solari. Mais il était, lui, insupportable avec sa manie de bourrer de journaux les cabinets. On le renvoyait alors avec colère; mais le lendemain il revenait.
Quand il dînait avec Cézanne, rue Boulegon, quelles clameurs affolaient la rue! Les passants s’arrêtaient, regardaient là-haut, à ce second étage, et ils croyaient à un assassinat. On montait alors dans un grenier, en face, et l’on voyait simplement Solari tout gonflé de son repas, et fumant sa pipette, appuyé sur sa chaise, tandis que Cézanne hurlait sans trêve.
D’autres fois, Cézanne allant peindre au Tholonet, il invitait son ami Solari à venir déjeuner avec lui au restaurant. Voici un de ces billets:
«Mon cher Solari.
«Dimanche si tu es libre et si ça te fait plaisir, viens déjeuner au Tholonet, restaurant Berne. Si tu viens le matin, tu me trouveras vers huit heures auprès de la carrière où tu faisais une étude l’avant-dernière fois que tu vins.»
«Bien cordialement, «Paul Cézanne.»
Solari fit, en effet, de la peinture, se laissant influencer par Cézanne. Il ne devint pas meilleur peintre que sculpteur.
Quelquefois Achille Emperaire, le peintre aixois, était de ces agapes. Rires alors et éclats de voix des trois amis, qui se mettaient, comme on dit dans le Midi, en goguette. Le pauvre Emperaire, le pauvre Achille, encore plus misérable que Solari, n’était pas habitué à une pareille fête. Alors il s’empiffrait et se piquait le nez si bien qu’un jour voulant prendre de l’eau pour se rafraîchir dans le ruisseau du Tholonet, il tomba la tête en avant, sauvé de la noyade tout de même par l’aide pourtant bien faible ce jour-là de Cézanne et de Solari. Après quoi ils s’en retournèrent tous trois vers Aix, cahin-caha, Emperaire tout triste, tandis que Cézanne se reprenait à hurler au nez de Solari.
Au demeurant Cézanne par ailleurs était le modèle de toutes les vertus provinciales.
Le dimanche, il ne manquait jamais par exemple d’aller à la messe; et il suivait l’office, le nez dans un épais paroissien. Il était croyant, certes; mais aussi il savait qu’en agissant ainsi, il causait un gros plaisir à sa sœur, Mlle Marie Cézanne, la vigilante gardienne de ses intérêts.
Mme Brémond tenait bien sa maison, préparait ses repas—et, au besoin, brûlait les toiles mal venues qu’il lui désignait;—mais Mlle Marie Cézanne restait la grande sœur que l’on écoute, que l’on suit; et comme elle lui disait de «s’appuyer sur Rome», il «s’appuyait sur Rome.» Pour les choses de Banque, enfin, elle y était mieux avisée que lui; et en cela encore il l’écoutait toute, content d’être délivré du souci de l’argent, pour lui un véritable casse-tête.
C’était déjà assez que de subir des semaines entières sans entrain, sans réussir au travail! Il y avait des jours où le feu de l’appartement ne s’alimentait que des toiles peintes crevées, déchirées par Cézanne. Combien il en a sauvées ainsi des mains de ces marchands qui tirent profit aujourd’hui des moindres «cherchements» de sa pensée; et qui font «compléter» des barbouillages informes, de sommaires schémas,—par quoi les faux pullulent et font au présent temps l’ornement des plus indésirables collections.
Au fond, Cézanne peu à peu s’épuisait, usé par le travail aussi bien que par le diabète. Et le travail seul le passionnait. Un détail intime que je dois dire ici, parce qu’il montre que Cézanne ne voulait point perdre une minute, une seconde, dès le moment qu’il s’était assis devant son chevalet: il tenait, près de lui, dans la chambre même où il travaillait, un urinal de façon à ne pas avoir à descendre chaque fois, nécessité qui, du fait de sa maladie, était très fréquente. Dans ces conditions, on comprend que livré à lui-même—et, d’ailleurs sur le chapitre de l’hygiène et de la toilette, ne voulant rien entendre—, on comprend que ce bourgeois d’Aix était comme une honte pour la Ville; et que, au surplus, il était imbécile d’accorder du talent—on disait même déjà du génie—à un tel loqueteux, à un si pauvre hère, muni de rentes, c’était entendu,—mais enfin les Officiels à Paris l’estimaient eux aussi à sa juste valeur!—pas même décoré, pas même reçu annuellement au Salon! Et cela, tout de même, c’était la consécration que les peintres, les vrais, refusaient avec mépris à Cézanne.
A ce moment nul bourgeois d’Aix n’eût voulu assurément poser devant Cézanne.
Il était tenu à ne rien vendre à Aix, pas plus une nature morte qu’un paysage; et si, plus tard, après la mort de Cézanne, on a retrouvé à Aix quelques toiles authentiques de lui, ce furent des toiles données ou oubliées par lui chez des gens.
Car, encore quelques années seulement avant sa fin, Cézanne offrait volontiers une ou plusieurs de ses toiles à qui admirait. On promettait de ne jamais se séparer de l’œuvre offerte; et le tour était joué. Quelques hommes de lettres acquirent des ressources momentanées avec des toiles ainsi subtilisées à Cézanne.
A l’écart, tout à fait à l’écart, soit qu’il fût dans son atelier du Verdon, soit qu’il se trouvât au motif, Cézanne besognait donc. Il n’avait même pas la ressource de la compagnie d’un modèle; car si les modèles hommes l’agaçaient, à Aix on n’eût pas admis qu’un modèle femme allât poser chez Cézanne, chez un vieillard aussi scandaleux! Une seule fois, Cézanne fit venir de Marseille une femme, mais ce fut le prétexte d’un tel éclat que, Mlle Marie Cézanne la première intervenant, il dut s’en tenir à cet unique essai. D’ailleurs, il avait été lui-même très mal à l’aise devant cette femme nue; et ce fut avec une véritable quiétude qu’il eut recours de nouveau à ses Académies dessinées chez Suisse et aux gravures du Magasin pittoresque, les meilleurs et les moins troublants modèles pour peindre ses Baigneuses.

LE PACHA
(Collection Auguste Pellerin)
PHOTO DRUET
Il ne pouvait même souffrir que Mlle Brémond passât trop près de lui. Il détestait, somme toute, et nettement, la si sympathique collectivité humaine. On le voyait tourner au coin des rues en toute hâte, comme toujours pourchassé; et son air furibond n’engageait point à lui adresser la parole.
D’ailleurs, ses anciens amis avaient presque tous quitté Aix; et quand, par hasard, il rencontrait le peintre Villevielle, l’ancien professeur de dessin au Cours du Musée d’Aix,—alors seulement il s’amendait d’abord; mais Villevielle restait bourré des plus froides traditions, et bientôt la conversation tournait mal.
Au fond, le désaccord entre Cézanne et Aix renaissait, complet. Les Aixois avaient connu Cézanne sous trois aspects différents: premièrement, avec les favoris, moustache et menton rasés; secondement, avec toute la barbe; troisièmement avec moustache et bouc, joues rasées. Chauve de très bonne heure, il n’avait jamais été, on l’a vu, un dandy: et c’est cela surtout, j’y reviens, qui exaspérait les Aixois. Par les illustrés, il admirait les allures d’un Carolus Duran, d’un Gervex; et cela, avouons-le, dégageait un autre piquant pour les amis des peintres. Ce Cézanne, il n’avait rien même des rapins, ces charmants plaisantins; il parlait bien quelquefois en provençal, mais il ne savait pas raconter ces savoureuses «bien bonnes» qui font éclater les habitués de café. Pouvait-on comprendre un homme aussi maniaque, aussi grincheux, qui avait cependant hanté les ateliers de Paris? Et puis, tout d’un coup, il s’emballait, furieux, enragé, hurlant à propos de tout, même quand il suivait un enterrement. «Un fou!» répétait-on, et les Aixois se racontaient que, maintes fois, ayant eu des discussions avec sa famille, il s’était caché pendant des semaines, ne donnant de lui aucune nouvelle.
Cézanne ne ménagea point à aucun moment ses forces. Il se fatiguait, s’exténuait jusqu’à ne plus pouvoir, au retour du motif, monter l’escalier de la rue Boulegon.
Un jour, en travaillant dans la campagne, il reçut la pluie et il prit froid. Ramené en voiture, il dit tout de suite à sa gouvernante, qui le soignait avec tant de vigilance: «Ce n’est rien, Madame Brémond, on me ramène jusqu’à ma chambre, mais ce n’est rien!»
Il se coucha; et une fluxion de poitrine se déclara. Le médecin vint; mais il ne put qu’incomplètement ausculter Cézanne; car le malade ne voulait point qu’on le touchât.
Il resta cinq jours au lit. Vers le dernier jour, il réclama par un télégramme son fils Paul-Alcide. Sa femme et son fils étaient absents. Il dit: «Paul n’est pas encore là! il ne viendra pas!»
Quelques heures après, le diabète se fit infectieux et Cézanne mourut.
C’était le 22 Octobre de l’année 1906.
Au lendemain de la mort de Cézanne, le Mémorial d’Aix, paraissant le mercredi et le samedi, publia un «Billet du Samedi,» signé: Sextius le Salyen, qui dut fort irriter les Aixois.
Voici ce billet:
Paul Cézanne
«Notre chère ville d’Aix, dont l’aspect si paisible éveille des idées de repos et de recueillement est cependant la ville de France qui a produit le plus d’esprits hardis et tourmentés.
«Il semble véritablement que le calme extérieur de cette cité permette aux caractères fortement doués d’atteindre leur développement et de se manifester dans toute leur plénitude, peut-être parce que nulle distraction extérieure n’est venue les entraver.—N’est-ce pas d’Aix, la ville parlementaire, la ville du cérémonial et de l’étiquette qu’a jailli la voix de Mirabeau qui fit la Révolution française? Un peu plus tard, nous avons eu ces hardis novateurs—pâles réactionnaires aujourd’hui, paraît-il—lesquels s’appelèrent Thiers et Mignet et implantèrent pour toujours le régime parlementaire en France. Et de même, si nous quittons le terrain politique pour nous réfugier sur les sommets de l’art, n’est-il pas remarquable de constater qu’en littérature et qu’en peinture la grande note moderniste a été donnée par deux Aixois: en littérature par Zola, père du naturalisme; en peinture par Cézanne, père de l’Impressionnisme.
«Certes, ces hommes à bien des points de vue divers et justement parce qu’ils étaient l’exacte expression, le reflet vivant de leur époque, ont été l’objet de discussions. Ils ont eu des admirateurs passionnés et de féroces détracteurs. Mais c’est justement là que réside le secret de leur force et de leur influence; on ne discute que ce qui existe, que ce qui vaut la peine d’exister.
«Lorsque, dans quelques années, on retracera l’histoire de la peinture au XIXe siècle, le nom de Paul Cézanne sera mis en vedette, comme celui d’un précurseur; on le rappellera un peu comme, lorsqu’on étudie le romantisme, on parle de Bernardin de Saint-Pierre et de Chateaubriand.—Né à Aix, en 1839, Cézanne a vécu sa longue existence tout entière, en beauté, je veux dire absorbé par son rêve qui était d’exprimer sur ses toiles les complexes aspects d’une nature insaisissable. Lorsqu’on lui parlait de son art il entrait rapidement dans une sorte d’état d’exaltation qui marquait bien à quel point ce peintre était tout plein de noblesse de son terrible métier. Alors que tant de médiocres se déclarent satisfaits pour peu de chose et arrivent bientôt à la seule perfection qu’ils puissent obtenir, Cézanne a passé sa vie à chercher, à chercher sans cesse. Il ne s’est jamais douté qu’il avait trouvé quelque chose et quelque chose de grand et de définitif; car si l’école du plein air existe, si nous avons Monet, Pissarro, Sisley, si les peintres ont compris la valeur de l’atmosphère et les mystères de la clarté qui baigne leurs paysages, c’est à Cézanne qu’ils le doivent parce que Cézanne est le premier qui ait peint comme cela.
«Bien loin de ceux qui se figurent que la brutalité est le signe de la force, que la crudité remplace la lumière, Cézanne a été le peintre des gris. Il a su discerner l’âme des paysages et simplifier sa peinture en lui laissant cependant toutes ses qualités essentielles.
«Depuis le fameux Mardi-Gras du premier Salon d’Automne, jusqu’aux derniers envois de cette année; jusqu’aux étranges aquarelles dont la simplicité puissante attestait un effort admirable, rien de l’œuvre du vieux maître n’est indifférent, rien n’est méprisable, rien n’est médiocre. Il est permis de haïr ce peintre, il n’est pas possible de le négliger. Il est permis aussi de l’aimer, de se souvenir de cette existence inquiète, toute passée dans l’angoissante recherche de la vérité, de cette œuvre qui marquera le point de départ d’une nouvelle période dans l’histoire de l’Art.
«Paul Cézanne est mort des suites d’une congestion pulmonaire contractée devant sa toile, en plein air, alors qu’il s’acharnait à peindre, insoucieux du reste, comme il fit toute sa vie durant. Nous l’avons accompagné à sa dernière demeure, par un de ces temps gris qu’il aimait tant et dont il savait si merveilleusement rendre toutes les délicatesses. M. le sénateur Leydet a prononcé de nobles paroles rendant hommage au maître disparu.
«Je voudrais que la ville d’Aix se souvînt de Cézanne, dont les toiles sont à Paris, au musée du Luxembourg, à Berlin, dans les principales grandes collections d’Europe et dont ni Aix ni Marseille ne possèdent la moindre esquisse. Il y aurait là un hommage tardif et si juste à rendre à la mémoire d’un peintre dont la renommée ne fait que grandir, dont l’influence sur son époque s’affirme de jour en jour. De même que nous conservons à la Méjanes des manuscrits de Zola, de même nous devons pouvoir montrer aux hôtes de notre beau musée que nous sommes ni des ingrats, ni des ignorants, ni des sectaires, ni des arriérés et que, lorsqu’un de nos compatriotes fait honneur à notre ville, notre ville à son tour est soucieuse de s’en souvenir.»
Considérer Cézanne comme un maître dans la ville qui n’avait jamais cru à la gloire du peintre, malgré tous les racontars venus de Paris, c’était vraiment l’acte d’un déplaisant fantaisiste; et, aussi bien, quand, un jour, il fut proposé au Conseil Municipal d’Aix de changer le nom de la rue Boulegon en celui de Paul Cézanne, un tel hourvari explosa que la proposition ne put même être développée.
Il me fut dit aussi que, dans son délire, Cézanne avait laissé échapper cette plainte: «Ah! ce Pontier!... ce Pontier!...» Elle visait l’actuel conservateur du Musée des Beaux-Arts de la Ville d’Aix, M. Henri Pontier, sculpteur, qui, quoique ou parce que condisciple de Paul Cézanne, ne voulut jamais admettre une toile de lui dans son Musée. Et pourtant les Musées de Paris, tous les plus grands musées de l’Europe possèdent des toiles de Cézanne, lui qui en eût donné avec joie dix, vingt, cinquante.
Certes, je sais que, dans les dires de Paris, se glissaient des injures, des incompréhensions totales, des affirmations catégoriques qualifiant Cézanne de raté, d’impuissant, de peintre voyant tout de guingois à cause de son diabète, etc. Je sais que des peintres d’Aix et de Marseille vociféraient leur admission dans les Salons Officiels de Paris, alors qu’on y refusait Cézanne. Tout de même, le fait était là: Cézanne vendait, vers ses dernières années, très cher ses tableaux; on était venu de Paris à maintes et maintes reprises pour en emporter, et cela au vu et au su du plus borné des Aixois; alors, comment ces gens-là, pour qui l’argent compte double, laissaient-ils la Commission de leur Musée se désintéresser de Cézanne?
Je n’arrivais pas à m’en donner une explication raisonnable; il fallait sans doute interroger Mlle Marie Cézanne.
Un ami m’ayant ménagé une entrevue avec Mlle Marie Cézanne, je me rendis place Saint-Jean, où demeure, en face du Musée, celle qui eut pour Cézanne une affection si dévouée et si attentive.
Il est très malaisé de rendre visite à Mlle Marie Cézanne. «Ces messieurs de Paris» (les marchands), ont trop joué pour elle des rôles de ravageurs, venant râfler jusque dans les coins les plus cachés des toiles de son frère. Elle n’a jamais voulu recevoir l’un d’eux. Très religieuse, ai-je déjà dit, elle tient à suivre tous les offices chaque jour, à écouter son confesseur le P. Desnoyelles; et, seules, une vieille bonne et une autre vieille fille, nommée Victorine Turc, troublent à peine le silence de la pieuse maison.
J’ai vu, toutes trois ensemble, trois toiles de Cézanne, au-dessus de la cheminée de la salle à manger.
D’abord, une admirable Montagne Sainte-Victoire; puis une copie d’un tableau, faite par Cézanne fort jeune; enfin, un troisième tableau quelconque représentant une jeune fille qui contemple un oiseau dans une cage.
J’ai interrogé discrètement Mlle Marie Cézanne. Elle m’a écouté; elle m’a laissé parler. Clairement, elle n’avait rien à me dire ou elle ne voulait rien me dire sur son frère. Pourtant, comme je me levais pour prendre congé, et comme je m’étonnais du petit nombre de tableaux conservés par elle, elle m’a dit, l’esprit ailleurs: «Oh! Monsieur, j’ai cette Sainte-Victoire parce que mon frère m’a forcée à la prendre, et pour ne pas lui faire de peine!.. Je n’ai jamais rien compris et je ne comprends encore rien à la peinture de mon frère!.. et, cependant, il me répétait assez: Marie, je te dis que je suis le plus grand peintre qui existe!»
Elle ne l’a pas cru—ni M. Henri Pontier,—les Aixois pas davantage;—et voilà pourquoi on ne voit pas une seule toile de Cézanne au Musée d’Aix-en-Provence!
Paris a tout de même moins malmené la gloire de Cézanne.
Le Salon des Indépendants, en 1899, 1901 et 1902 s’était rehaussé en exposant des toiles de Cézanne; et à l’exposition du Salon d’Automne de l’année 1905, Cézanne reparut, très magnifique. Mais ce fut surtout, dès l’année 1907, qu’une exposition rétrospective d’un certain nombre de ses œuvres illustra le jeune Salon d’Automne d’une forte renommée. Au moins une élite honorait la Peinture.
On vit exposées cinquante-six peintures et aquarelles, la plupart prêtées par M. Auguste Pellerin, les autres œuvres appartenant à MM. Cézanne fils et Gangnat.
Parmi ces cinquante-six œuvres on peut citer: l’Avocat; l’Homme à la blouse blanche; la Tentation de Saint-Antoine; la Femme au boa; Le Veau d’or; la Pendule; la Taverne des Brigands; Paysage en montagnes; Léda; Les joueurs de cartes; le Portrait de M. Gustave Geffroy; les Baigneuses; la Paysanne; la Table de cuisine; la Dame en noir; Le Bassin du Jas de Bouffan; la Vallée de l’Arc; les Deux Promeneurs; la Montagne Sainte-Victoire; Paysage d’Auvers; la Bouteille de cognac; l’Arlequin; la Montagne rocheuse; Le Grand Arbre; la Carafe; le Compotier; la Femme au chapelet; le Château noir; Un vieillard; Madame Cézanne; Arbres et roches; Paysage bleu; etc., etc...

LA TENTATION DE SAINT ANTOINE
(Collection Auguste Pellerin)
Depuis, on sait quel sort a été réservé aux œuvres de Cézanne. Nul n’est plus enviable; nul n’est plus noble, puisque si Cézanne n’est pas représenté au Musée d’Aix-en-Provence, sa ville natale, des œuvres de lui figurent à Paris aux Musées du Louvre—et du Luxembourg (salle Caillebotte); et, à l’étranger, aux Musées de Christiana, d’Helsingfors, d’Elberfeld, de New-York, de Mannheim, de Munich, de Berlin, etc., etc.
Quant aux grandes collections particulières (la plus opulente est, on le sait, celle de M. Auguste Pellerin), elles se glorifient toutes de posséder des tableaux de Cézanne. Un seul et cuisant regret à exprimer:
Les toiles et les aquarelles de Cézanne ayant sauté d’un bond à une cote extraordinaire, tous les marchands se sont rués sur les moindres esquisses pour satisfaire la clientèle attardée et abêtie des amateurs.
On a recherché—Dieu sait où!—les bouts de toiles, les esquisses interrompues, les crayonnements lavés de trois tons, tout l’embryon abandonné d’une œuvre, tout ce que le feu n’avait pas dévoré; et, de tout cela on a entretenu la gloire de Cézanne. On a fait pis encore: on a complété des dessins, des esquisses; et toutes ces ignominies, tout ce mercantilisme, contre lequel personne ne proteste, s’étale au grand jour, aux vitrines les plus connues; et les amateurs béats, bâillent, admirent ce dévoiement d’une œuvre, ce honteux trafic qu’attisent d’immodérés profits!
Celui que Huysmans appelle «l’auteur des vigilantes et sagaces critiques d’avant garde», M. Théodore Duret, le premier critique en tout cas par qui nous connûmes les Impressionnistes, a écrit dans son livre: Les Peintres impressionnistes, un chapitre dont je vais reproduire d’utiles extraits; car il est impossible d’exprimer, plus simplement, ce que Cézanne est venu dire, à côté et au milieu du groupe, baptisé de ce seul nom imparfait et incomplet: Les Impressionnistes.
«Il est probable (dit M. Théodore Duret) qu’on ne verra jamais se déchaîner contre quelques peintres que ce soient, l’hostilité que les Impressionnistes ont eue à subir. Pareil phénomène ne saurait se répéter. Le cas des Impressionnistes, où la flétrissure première a fait place à l’admiration, a mis l’opinion en garde. Il servira sûrement d’avertissement, et devra empêcher qu’un soulèvement, tel que celui que nous avons connu, ne se produise jamais plus contre les novateurs et les originaux qui pourront encore survenir. S’il doit en être ainsi, Cézanne aura fourni un exemple appelé à demeurer unique. Si les Impressionnistes sont destinés à rester les peintres qui auront été de tous les plus maltraités à leur apparition, Cézanne, qui, au milieu d’eux, a été sans comparaison le plus honni, aura eu ainsi l’honneur d’être de tous les artistes originaux, jamais apparus dans le monde, celui qui aura le plus fait rugir les Philistins. En lui l’originalité et la physionomie à part se seront manifestées de manière à trancher, plus qu’elles ne l’avaient encore fait auparavant, sur les formules courantes de l’art facile, admis de tous. Il faut voir d’où venait ce fait.
«Cézanne devait d’abord sa physionomie à part, à la circonstance qu’il n’était entré dans l’atelier d’aucun peintre en renom pour y apprendre à produire selon la formule courante. Sa manière offrait par cela même un aspect insolite et aux traits déconcertants. Les ateliers parisiens sont arrivés à former en nombre illimité des peintres, qui travaillent d’après des règles si sûres, qu’on peut dire de leurs œuvres qu’elles sont impeccables. Des centaines se montrent tous les ans aux Salons, dessinant des contours et peignant des surfaces sans défauts. On n’a rien à reprocher à leurs envois, on n’y découvre aucun manquement. Seulement tous ces gens-là se ressemblent, ont même facture, même technique. Leurs œuvres finissent par exciter le dégoût de ceux qui recherchent en art l’originalité et l’invention, mais avec leur correction routinière, elles donnent une régularité générale du dessin, un aspect convenable des formes, qui ont si bien pris les yeux, que tout ce qui en diffère paraît au public fautif, mal dessiné, mal peint. Or Cézanne, par sa manière à part très tranchée, venait heurter violemment le goût banal, habituel du public. Il était avant tout peintre et ne dessinait pas, en arrêtant des lignes et des contours à la manière des autres. Il appliquait, par un procédé personnel, des touches sur la toile, les unes à côté des autres d’abord, puis les unes par-dessus les autres après. On peut aller jusqu’à dire que, dans certains cas, il maçonnait son tableau, et de la juxtaposition des touches colorées, les plans, les contours, le modelé, se dégageaient pour ceux qui savaient voir, mais pour les autres, restaient noyés dans un mélange uniforme de couleur. Cézanne avant tout peintre, dans le sens propre du mot, recherchait avant tout la qualité de la substance peinte et la puissance du coloris. Mais alors, pour ceux qui ne comprennent le dessin que par des lignes précises et arrêtées, il ne dessinait pas; pour ceux qui demandent à un tableau d’offrir des motifs historiques ou anecdotiques, les siens, ne présentant rien de pareil, étaient comme non existants; pour ceux qui veulent des surfaces recouvertes également, son faire, par endroits rugueux et ailleurs allant jusqu’à laisser des parties de la toile non couvertes, paraissait être celui d’un impuissant; sa touche par juxtaposition de tons colorés égaux ou se superposant, pour arriver à de fortes épaisseurs, semblait grossière, barbare, monstrueuse.
«Il existait cependant une particularité d’ordre tout à fait supérieur dans ses œuvres, mais aussi précisément de telle sorte que le public en général, les littérateurs et même le commun des peintres ne peuvent d’abord ni comprendre, ni apprécier, puisque d’abord ils ne peuvent même pas la saisir, c’est la valeur en soi de la matière mise sur la toile, la puissance harmonieuse du coloris. Or les tableaux de Cézanne offrent une gamme de coloris d’une intensité très grande, d’une clarté extrême. Il s’en dégage une force indépendante du sujet, si bien qu’une nature morte—quelques pommes et une serviette sur une table—prendront de la grandeur, au même degré que pourra le faire une tête humaine ou un paysage avec la mer. Mais la qualité de la peinture en soi, où réside surtout la supériorité de Cézanne, n’étant point accessible aux spectateurs, tandis que ce qu’ils tenaient pour monstrueux, leur crevait les yeux, les rires, les sarcasmes, les injures, les haussements d’épaules, étaient les seuls témoignages que ses œuvres leur parussent mériter, et qu’aussi bien ils leur prodiguaient.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Il continua à peindre de la façon la plus assidue, la plus tenace. Son cas est ainsi remarquable dans l’histoire de la peinture. Voilà un homme qui, en montrant ses œuvres, a été tellement maltraité, qu’il s’abstient de les remettre de nouveau sous les yeux du public. Rien ne peut lui laisser entrevoir que l’opinion changera à son égard dans un avenir prochain ou même jamais. Ce n’est donc pas pour ce qui miroite au regard de tant d’autres, le renom, les honneurs à acquérir qu’il travaille, puisque ces avantages lui paraissent définitivement refusés. Ce n’est pas non plus en vue d’un profit, puisque après l’horreur causée par ses œuvres, il n’a aucune chance d’en vendre, ou s’il en vend quelques-unes exceptionnellement, il n’en obtient qu’une somme infime. D’ailleurs, il n’a pas besoin de produire pour vivre comme tant d’autres qui, une fois engagés dans la carrière ont à lutter contre la misère. Il jouit, lui, d’une pension de son père qui l’alimente, en attendant le jour où l’héritage paternel le fera riche. Il ne continuera donc à peindre par aucun de ces motifs, qui décident généralement de la conduite des autres. Il continuera à peindre par vocation pure, par besoin de se satisfaire lui-même. Il peint parce qu’il est fait pour peindre. On a ainsi avec lui l’exemple d’un homme que son organisation mène à faire forcément une certaine besogne. Evidemment les yeux qu’il promenait sur les choses lui procuraient des sensations tellement particulières, qu’il éprouvait le besoin de les fixer par la peinture et qu’en le faisant, il ressentait le plaisir d’un besoin impérieux satisfait.
«Puisqu’il peint maintenant uniquement pour lui-même, il peindra de la manière, qui lui permettra le mieux d’obtenir la réussite difficile qu’il conçoit. Il n’y aura donc dans sa facture aucune trace de ce que l’on peut appeler le virtuosisme, il ne se permettra jamais ce travail facile du pinceau, donnant des à peu près. Il peint de la manière la plus serrée. Il tient au travail les yeux obstinément dirigés sur le modèle ou le motif, de manière à ce que chaque touche soit bien mise, pour contribuer à fixer sur la toile ce qu’il a devant les yeux. Il pousse si loin la probité à rendre sincèrement l’objet de sa vision, il a une telle horreur du travail fait de chic, que lorsque dans son exécution, il se trouve par endroits des points de la toile non couverts, il les laisse tels quels, sans penser à les recouvrir, par un travail postérieur, de reprises des parties d’abord négligées, auquel se livrent tous les autres.
«Son système le contraint à un labeur en quelque sorte acharné. Ses toiles en apparence les plus simples demandent un nombre considérable, souvent énorme de séances. Ses procédés ne lui permettent non plus d’obtenir cette réussite moyenne certaine, à laquelle les autres arrivent. Il abandonnera en route nombre de ses toiles, qui resteront à l’état d’esquisses ou d’ébauches, soit que l’effet recherché n’ait pu être obtenu, soit que les circonstances aient empêché de les mener à terme. Mais alors les œuvres parvenues à la réussite complète laisseront voir cette sorte de puissance, que donne l’accumulation d’un travail serré cependant resté large, procurant l’expression forte et directe.»
D’un autre côté, j’ai noté, d’après Huysmans, pour la manière de Cézanne «un hourdage furieux de vermillon et de jaune, de vert et de bleu, une peinture maçonnée avec une truelle, rebroussée par des roulis de pouce.»
Environ jusqu’à l’année 1880, Cézanne empâta, en effet, singulièrement ses toiles. Il s’acharnait dans des amas de couleurs, dans des reliefs de ton. Il cherchait la forme en entraînant sous sa brosse des limons de pâte. Aussi, disposait-il, près de son chevalet, des petits camions de couleurs pour pouvoir toujours accrocher à sa brosse de suffisantes boules qu’il forait, qu’il râtissait ensuite en fonçant vraiment dans la toile. Puis, las de «modeler cette sculpture», comme il disait lui-même, Cézanne, pendant une longue période, peignit doucement, lentement, en juxtaposant les tons les plus précieux (de la couleur toujours au bout de sa brosse), en les recouvrant aussi quelquefois de glacis très fins; ce qui ne l’empêcha point de revenir encore, plus tard, à la peinture en épaisseur.
Sa méthode de travail, vers 1899, par exemple, (au moment où il peignait le portrait de M. Vollard), elle est expliquée tout au long dans le chapitre que M. Vollard a intitulé: Mon portrait. C’est un chapitre très amusant et qui, quoique respectueux, détaille fort complètement tous les tics de Cézanne, toutes ses manies, toutes les circonstances favorables qui étaient nécessaires pour qu’il travaillât: bonne situation politique et militaire générale; état pacifique des entours de son atelier, sis alors rue Hégésippe-Moreau; les chiens muselés, M. Vollard, pendant la pose, immobile comme une pomme, etc. Sans doute, Cézanne, ainsi, n’apparaît pas comme un homme très sur de lui-même; il est très loin d’être un Olympien ou un rude lapin, comme M. Bonnat, par exemple; il a des colères soudaines et des angoisses inexpliquées; enfin, il est incivil et crédule. Certes; mais c’est qu’il était ainsi, vraiment; et tout cela à la fois. Rendons cet hommage à M. Vollard et à la Vérité!
Si vous voulez d’autres détails touchant la façon de peindre de Cézanne, sa palette, ses couleurs, etc., vous les trouverez dans le livre de M. Vollard: Paul Cézanne. Vous trouverez tout cela, et bien d’autres choses encore, qui font assurément de ce livre une sorte de roman très attachant et très substantiel.
De son côté, Octave Mirbeau a écrit: «Oui, nous avons en Cézanne le plus peintre de tous les peintres, un peintre qui jamais n’embarrassa son œuvre de préoccupations étrangères à la peinture, qui répudia comme une malhonnêteté tous les vains et faciles ornements, tous les escamotages, tous les truquages et qui respecta la nature jusqu’au point de paraître, comme elle, quelquefois enfantin, naïf et impuissant. Il chercha dans la vérité innombrable la source unique de son inspiration, et fit son unique et merveilleuse joie d’une discipline sévère et d’un travail acharné. Et sa discipline, la vraie, la seule qui ne soit pas dégradante, n’était que la plus inquiète recherche, que l’acharnement d’un esprit jamais satisfait et qui ne peut jamais l’être. Car, s’il est facile de suivre les dogmes d’un art, la joie cruelle de ceux qui ont la nature pour maître est de savoir qu’ils ne l’atteindront jamais.
«Ceux qui ont transformé le classicisme de Cézanne en une sagesse scolaire n’ont pas deviné que l’incomparable joie qu’il eut à peindre, à peindre toute sa vie, était singulièrement proche du supplice de Tantale.»
Ailleurs, Octave Mirbeau a dit: «Il est toujours absurde de commenter les peintres. Et quand il s’agit de celui-là (Cézanne), le plus grand entre les plus grands, cela devient une sorte de sacrilège. Lui prêter des intentions littéraires, imaginer même que la littérature—ne fût-elle pas d’un critique d’art ou d’un esthète—puisse faciliter la compréhension de son œuvre, en restituer—si lointainement que ce soit—la pensée ou le sentiment, c’est plus qu’ignorer Cézanne, c’est le blasphémer.»
Pourtant, qui de nous peut résister à commenter l’œuvre de Cézanne? Et ils abondent déjà, ces commentaires. De quelles épithètes n’a-t-on pas surchargé cette œuvre! Les uns ont vu en Cézanne un constructeur, un amoureux des volumes, un ordonnateur de rythmes et de sonorités, un hypersensible—c’était cette sensibilité extrême, disent ces uns, qui le poussait à déformer, pencher, déséquilibrer ses natures mortes!—Les autres ont écrit qu’il «avait recommencé» Nicolas Poussin; qu’il n’avait point peint la Provence, mais des paysages éternels, surnaturels, de tous les temps et de tous les lieux; que, peintre, il était aussi architecte; qu’il avait exprimé pour la première fois des paysages vierges; et, enfin—j’omets à dessein d’autres opinions savoureuses—qu’il avait peint, pour tout dire comme Dieu avait créé le Ciel et la Terre! On ne peut plus, n’est-ce pas? après cela, parler de rythme, d’harmonie, de décor ou de style! C’est bien là un dernier commentaire qui les résume tous.
Pourtant, l’on peut dire que si la plupart des vrais peintres sont de parfaites brutes, Cézanne fut, lui, un peintre intelligent, raisonnable et entêté. Il ne laissa jamais rien au hasard; il voulut continuellement que sa peinture fût disciplinée, allât à son résultat par des moyens honnêtes, sans surprise, sans mensonge. Il peignit comme un mosaïste place ses petits dés de couleur, un à un. Quand on aime la peinture de Cézanne, on vomit la peinture qui doit tant d’apparentes réussites à de condamnables procédés. Aujourd’hui, l’«infernale commodité de la brosse», que Delacroix exécrait, nous accable d’innombrables tableaux dont le sort est fixé d’avance. Il faut haïr de toutes ses forces les virtuoses, et surtout les peintres que j’appellerai: les professionnels de l’essence. Toute peinture doit avoir apparence d’émail. La peinture de Cézanne est, au premier chef, une exaltation raisonnée et intelligente des couleurs, ces fleurs de la palette.
Gardons-nous donc de tout commentaire philosophique, littéraire et nuageux; et notons seulement quelques aspects des paysages que Cézanne représenta depuis le moment de l’Académie Suisse jusqu’à sa mort, en l’année 1906.
Aussi bien, écrire autre chose, ce serait retomber dans le charabia prodigieux (volumes, sonorités, science et hypothèse, force et matière, etc...) dont s’orne la prétentieuse nullité de la plupart des jeunes peintres d’aujourd’hui.
Quand Cézanne va peindre, en compagnie de Guillaumin, dans l’ancien parc d’Issy-les-Moulineaux, alors il est sous l’influence—qui lui laisse cependant de larges coudées—de Courbet. Il peint des paysages serrés, gravement, religieusement. Aucune virtuosité, aucune envie d’étonner.
Et dès ce moment son humeur pictural—si je puis ainsi dire—est fixé. Devant la nature, il sera toujours grave, méditatif, sérieux. Alors que ses camarades réaliseront pour la plupart du temps des paysages gais, triomphants, dans la joie de vivre et de peindre, lui, il demeurera toujours, avec le plus grand amour de peindre qui fût jamais, un triste, un silencieux, têtu devant un paysage comme devant un problème à résoudre.
Depuis ce moment encore, il tâtonnera fortement, angoissé de voir, de deviner tant de vie secrète nourrissante, au plus profond des arbres, au plus lourd humus de la terre. Au début, il voudra suivre Guillaumin, Pissarro qui peignent vite; ses essais, en ce sens, seront stériles. Il sortira de cette tâche fourbu, épuisé, le cœur vide, avec un dégoût profond de la peinture.
Aussi, il n’insistera pas. Et dès son arrivée à Auvers-sur-Oise, où il rejoint Pissarro, Guillaumin et Vignon, il est plus que résolu à peindre comme un bœuf laboure, puisque, sans le vouloir, sans faire le moindre effort, sa nature est stabilisée, et qu’il peint maintenant lentement, patiemment, sans même s’apercevoir que quelqu’un à côté de lui peint d’une tout autre manière; ce qui ne l’empêchera pas, par délassement, de copier plusieurs fois des tableaux de son ami Pissarro.
La maison du pendu, que vous voyez au musée du Louvre, est de cette période-là. Feu le comte de Camondo, banquier juif et portugais, était très fier de posséder cette toile. Un jour, Claude Monet, l’en ayant, par une lettre, félicité,—la dite lettre fut gardée dans une poche cousue derrière la toile; et, aux visiteurs du dimanche, le comte, rassuré devant l’opinion publique par la lettre venue bien à point de Monet, en donnait lecture, avec de béats et triomphants sourires. Malgré tout, cette toile ne l’emportait pas sur les autres toiles que le père Tanguy vendait, toutes de cette période-là, en deux piles, l’une à quarante francs, l’autre à cent francs le tableau.
«M. Cézanne, en peignant, plaquait!» m’avait dit un paysan d’Auvers. Et, en effet, la touche en carrés se différenciait singulièrement du métier épinglé, en hachures, en virgules de Pissarro, de Sisley et de Monet. Pissarro, aussi, était bien parti de Courbet, comme les autres, comme Renoir, comme Sisley; mais, inquiet dès le premier jour, instable comme il le restera sa vie durant, il affectionnait maintenant ces mille petites touches, ce travail de tapisserie au petit point, pour aider à la vibration, au poudroiement de la lumière, à l’exaltation du pigment coloré. Et cela constituait du flou continuel, mangeait les contours, noyait tout le paysage, maisons, arbres, champs, animaux et paysans, dans une poussière blonde, qui n’était assurément point sans charme, venant après tant de peintures conventionnelles et arrêtées; mais qui, aujourd’hui, nous fatigue, tant nous avons soif de précision, de contours et de choses construites.
Or, Cézanne que certaines gens accusent encore maintenant de «n’avoir jamais fait un tableau», voulut, toute sa vie, et chaque fois qu’il était devant son chevalet, faire un tableau. Jamais il ne sacrifia rien à «la commodité—je le répète—infernale de la brosse». Il songea toujours à «construire», à «peindre solide»; quand il bâtissait des maisons sur sa toile, à dessiner, à arrêter nettement leurs arêtes; et les verticales apparaissent peu verticales au sol, et les horizontales peu horizontales, uniquement à ces gens que la rigidité du cordeau a abêti; et qui n’ont jamais vu que, lorsqu’on domine un paysage les maisons s’élargissent à la base, tandis que les horizontales s’infléchissent ou se courbent. Les jeunes peintres d’aujourd’hui (ils viennent presque tous de Cézanne) appellent cette «infraction» à la géométrie pure: un excès de sensibilité; et c’est pourquoi ce sont eux surtout qui multiplient dans leurs toiles les lignes de travers, les maisons pochardes et les toits bancroches.
Or, quelle injure picturale c’est là à ce peintre qui était si sincère, si conscient du lourd devoir qu’il avait à remplir, puisqu’il avait choisi sciemment cette profession de peintre, très noble, très héroïque, mais aussi très décriée par toute une ville provinciale, si orgueilleuse de ses négociants et de ses magistrats.
Cézanne n’a pas «recommencé le Poussin»; et cela est bien pour l’un et pour l’autre; mais, comme chez le Maître des grands paysages historiques, quelle gravité ordonnée chez Cézanne! De quelle beauté silencieuse sont imprégnés ses paysages; et quelle étrangeté et quelle totale originalité!
Quand on entre pour la première fois dans une salle où sont rassemblés des tableaux de Cézanne, on ne les voit pas tout d’abord. Ils n’ont rien à vous dire, si vous avez l’intention de les regarder à la dérobée. Ce ne sont pas des tableaux de Salon; encore moins des tableaux qui raccrochent. N’importe quel vil barbouilleur en sait plus sur ce chapitre-là que le maître d’Aix. Il est facile, somme toute, de faire hurler les couleurs; d’opposer des contrastes fulgurants, des arcs-en-ciel de marchands de couleurs. Les étalagistes aussi dressent avec éclat des vitrines de bas de soie. Les fleuristes enfin savent étaler d’aveuglantes crudités de ton. Cézanne, lui, est toujours morose d’apparence; sa peinture est souvent rébarbative; elle ne livre ses lointains secrets d’enchantement et de joie qu’à ceux qui s’attachent à elle. Elle ne se fait aimer que de ceux qui ont le loisir de l’amour.
Au rebours, un paysage de Claude Monet, un paysage de Renoir peuvent tout de suite vous plaire. Ils jettent d’un coup leur fanfare de couleurs, et déjà vous la connaissez toute. Aucun besoin de méditation; c’est un charme des yeux, un charme complet, surtout s’il s’agit d’un paysage de Renoir,—et c’est tout! Vous n’avez pas besoin de revenir devant le tableau; il vous a enchanté, d’un coup; et vous devinez qu’il a été peint sans fatigue, sans émoi; et que, demain, un autre paysage de Renoir vous causera à peu près identiquement la même joie.
Ce n’est pas que Cézanne ait eu plus d’imagination que Renoir; mais il a un autre sens de l’étrangeté; et, dans l’analyse comme dans la synthèse, il va autrement loin que le peintre charmant.
Souvent Cézanne fait penser au Greco. Il en a toute la noirceur tragique, toute l’angoisse immatérielle, toute la construction barbare. Surtout dans ses paysages de maisons: villes et villages.
Je ne veux point décrire les toiles célèbres qui me font songer à cet auguste souvenir. La photographie a vulgarisé ces amoncellements de toits, ces clochers baignant dans les ténèbres d’un ciel funèbre, ces maisons toutes échafaudées en oraisons de pierres, ces fenêtres pesantes closes ou ouvertes sur la tristesse de la vie comme des yeux résignés à force d’épouvante.
Sans doute, il y a de nombreux autres paysages de Cézanne; ceux-ci plus tranquilles, et comme tout graves de sérénité. La campagne d’Aix lui a fourni maints tableaux de ce genre. Il a su, cette fois, chérir d’un amour attendri les champs, les murs, les arbres, les petites bastides éparses çà et là comme des bornes blanches de la campagne romaine. Il a recherché les arbres qui viennent de naître, les frêles arbrisseaux si verts sur la terre rouge. Il a exprimé, en ardent amoureux de l’azur, les vols éperdus des pins, les contorsions que le mistral impose à ces arbres du vent. Il a chanté aussi les masures qui prennent racines au profond de l’humus; il a plongé dans l’onde de l’Arc ou de la Marne les reflets lourds des arbres gonflés de sève; il a aimé les marronniers du domaine paternel, la douce immobilité de la pièce d’eau du Jas de Bouffan; il a gîté dans des arbres caressants de paisibles maisons toutes blanches au chapeau tout bleu; il a peint des rues, où, devant des parcs, des maisons heureuses viennent s’offrir au passant; il a glorifié les collines, les hautes herbes, les panaches, les branches qui retombent comme des palmes; il a, au bord de la mer bleue, étagé de gais villages aux toits rouges; il a noirci de mystère des allées de parcs anciens; il a, lui aussi, peint des sous-bois où, le long des étroits chemins, se pressent comme à une procession les jeunes bouleaux et les tendres acacias; il a, sur des routes défoncées par les charrois, abandonné des maisons, tristes, comme de pauvres vieilles; il a élancé dans la nue la flamme des peupliers; il a bâti le roc qui plonge dans la mer et le toit de la maison ployé par la colère de l’ouragan; il a peint le grand arbre qui est comme le père de la campagne endormie, apaisée sous sa sollicitude; et, toujours brûlé par sa passion, toujours sous la morsure de la chimère, il a cheminé, dressé partout son appareil de supplice, sentant sa vie s’en aller brutalement par tout son sang dont il nourrissait les arbres et les champs, lui qui criait, jurait, sacrait, de les voir toujours superbes, impassibles; même le chant incessant des cigales n’était-il pas comme une dérision à son effort toujours borné, à tant de tentations pas abouties, à sa sacrée peinture dont un jour il crèverait bien, enfin pacifié?
Si l’on appelle tableaux les solennelles, compliquées et fastueuses natures mortes dont nous surchargèrent sans trouble les peintres des Flandres et certains Français des dix-huitième et dix-neuvième siècles, à coup sûr, alors, les natures mortes de Cézanne ne sont pas des tableaux.
Mais si, dégagé de ce fatras de mille objets disparates—ne voit-on pas représentés dans les tableaux susvisés des fruits, des fleurs, des tapisseries, des coupes d’orfèvrerie, des animaux, des instruments de musique, des armes et des armures, des paysages et des fonds de ville, des statues et des colonnes, des meubles et des vêtements, etc. etc.?—si, dis-je, libéré de cet invraisemblable amas de choses saugrenues, on ne veut considérer que l’éloquente simplicité d’une toute petite partie de la nature naturelle et confectionnée—puis-je ainsi dire!—à coup sûr les natures mortes de Cézanne sont des tableaux.
Et comme il ne nous opprime pas, lui! Une serviette, des fruits, un compotier, quelquefois, en plus, un pot, une bouteille—et voilà, grâce à la magie de son admirable métier de peintre, une attachante œuvre.
Je ne nie point, certes, les réussites d’un Chardin et ses natures mortes toujours apprêtées, toujours précieuses; je ne mets pas davantage en doute les majestueuses avalanches de tons d’un Snyders; je reconnais qu’un Johan Van Kessel a su disposer pour le plus vif plaisir des yeux un groupement ingénieux et riche; enfin, dans notre dix-neuvième siècle, Delacroix, ce peintre universel, et, tout près de nous, l’extraordinaire Van Gogh, ont enchaîné notre admiration perpétuelle au dessus de certaines de leurs natures mortes; mais les natures mortes de Cézanne ne sont-elles pas plus émouvantes que toutes les autres natures mortes? ne dépassent-elles pas en étrangeté même les plus inouïes, les plus barbares, les plus rares natures mortes de Van Gogh?
Elles ont un accent particulier, inconnu jusqu’alors, qui vient peut-être de l’incroyable «solidité» qu’affirment les objets représentés. Remarquez ses pommes, ses autres fruits, pétris, modelés chacun comme pour une vie éternelle. Autant de petites sphères, de petits cônes, de petits cylindres baroques, qui sont recréés, à l’abri cette fois de toute fermentation. Et si la diversité infinie de la nature a bien été comprise par un peintre, ce fut à coup sûr par Cézanne. Certes, on reconnaît toujours son style—parbleu! puisqu’il l’a fait si fortement le sien!—mais pour chaque fruit, Cézanne, patiemment, recommence à dessiner, à peindre, comme s’il découvrait pour la première fois l’espèce de fruit qu’il a à représenter. En comparaison, revoyez toutes les natures mortes des Musées: les fruits toujours dessinés, toujours peints de la même manière; aucune physionomie différente de fruits; un modèle unique, un type invariable; quelques changements de place dans la composition du tableau; et c’est tout, on ne compte que sur la virtuosité du pinceau qui fera le tapage nécessaire pour fixer dans une béatitude émerveillée le passant.
Cézanne, lui, peignit chaque fois avec une peine infinie—c’est toujours la même chanson dès qu’il s’agit de lui!—ses natures mortes. On se plaît à raconter que, souvent abandonnées, il les reprenait et que, de nouveau abandonnées, pour être reprises plus tard, ce manège durait des années. L’anecdote connue des fleurs en papier, qui lui servirent une année durant de modèles et qui, au bout de quelque temps, avaient tout de même «changé»,—ce qui l’indigna fort!—symbolise, précise le lent acharnement de Cézanne à la conquête de la vérité. Au fond, c’est lui-même qui a été—pour les esprits de travers—le propre artisan de leurs tenaces incompréhensions actuelles. Ne répétait-il pas sans cesse, à propos de ses natures mortes, que c’étaient là de simples études, et qu’un jour il réaliserait, ayant beaucoup travaillé, le bon tableau? Les esprits de travers ont pris à la lettre ce dire d’un peintre toujours mécontent de soi, détruisant à plaisir de nombreuses œuvres; et, niaisement, ils en concluent que Cézanne n’a jamais produit que des essais, que des ébauches ou autres commencements d’œuvres. Eh bien! essayez seulement de confronter avec n’importe quelles natures mortes du Musée du Louvre la Nature morte à la Commode (aujourd’hui à la vieille pinacothèque de Munich), la nature morte au châssis, la nature morte à la statuette, etc., etc. et vous discernerez de quel côté il convient de fixer votre admiration, si vous n’avez pas, vous aussi, l’âme et les yeux de travers!
Je concède, d’ailleurs, que l’imagination de Cézanne n’est pas allée, dans ses natures mortes comme dans ses paysages, au-delà de toute fantaisie. Pour lui, toute imagination se borna à l’invention pour son propre compte d’un métier fort singulier, et à la découverte de quelques «petites sensations», lui, Cézanne, prétendant même qu’il n’avait en tout et pour tout à son compte qu’une seule «petite sensation»;—et encore, accusait-il Gauguin de la lui avoir ravie. C’est Mirbeau qui raconte ainsi cette douce plainte de Cézanne: «Un jour il nous disait: «Ce monsieur Gauguin, écoutez un peu... Oh! ce monsieur Gauguin... J’avais une petite sensation, une toute petite, toute petite sensation. Rien... ce n’était rien... ce n’était pas plus grand que çà... Mais enfin, elle était à moi, cette petite sensation. Eh bien! un jour, ce monsieur Gauguin, il me l’a prise. Et il est parti avec elle. Il l’a trimballée sur des paquebots, la pauvre!.. à travers des Amériques... des Bretagnes et des Océanies, dans des champs de canne à sucre et de pamplemousses... chez les nègres, est-ce que je sais? Est-ce que je sais ce qu’il en a fait? Et moi, maintenant que voulez-vous que j’en fasse? Ma pauvre petite sensation!» Et Cézanne soupirait, gémissait comme un enfant.»
Qu’eût-il dit, alors, du pillage qui suivit sa mort? de cette clique de peintres abattus sur son œuvre, et la plagiant, la volant, la détroussant! Voilà douze ans, treize ans que Cézanne est allé rejoindre aux Champs-Elysées les souveraines ombres du Greco, de Delacroix, de Rembrandt; et encore maintenant des peintres, ayant dépassé la quarantaine, le plagient, lui volent, non plus sa «petite sensation» déjà volée une fois, mais toutes ses sensations, jusqu’à sa façon si personnelle de dessiner, jusqu’à ses indications par taches d’aquarelle, jusqu’à ses constructions de maisons, jusqu’à ses formes d’arbres,—et quels massacres en résultent!
Pour ses natures mortes, le pillage est encore plus absolu. En avons-nous vu—et en voyons-nous de ces pommes dans des compotiers ou dans des assiettes sur une serviette blanche! A-t-on assez ressassé «l’éloquence» des trois pommes, simplement peintes! Et l’on a copié encore ici jusqu’aux prétendues déformations de Cézanne! Car, des peintres très capables de tracer une ligne à peu près droite ou un ovale acceptable, ont systématiquement imité Cézanne, se sont obligés à dessiner comme lui, sans comprendre, par lourde impudeur de paresseux plagiaires.
J’ai dit qu’il reprenait souvent ses natures mortes. Oui, pour lui, ces études-là n’étaient jamais finies. Combien d’entre elles restaient des mois retournées contre les murs, ou dormant sur des chevalets ou même abandonnées dans des coins noirs de ses ateliers successifs! C’est ainsi que s’est établie la légende des toiles laissées par Cézanne en pleine campagne, parce qu’il était mécontent de son travail. En vérité, il avait beaucoup de toiles en train; et, comme il avait ordonné une fois pour toutes de ne toucher à rien dans son atelier, souvent des arrangements de natures mortes s’y éternisaient; et l’on devine dans quel regrettable état il retrouvait un beau jour, entêté et rageur, ses fruits, ses fleurs et jusqu’à l’ancienne blancheur de la serviette passée maintenant au gris sale de toute la poussière accumulée.
En tout cas, un modèle de nature morte, c’était muet; et il était tout seul avec ce modèle-là, dans son atelier. Double condition pour qu’il fît un bon travail. On s’explique alors qu’il ait peint tellement de natures mortes: celles qu’il a laissées en vie et celles, en très grand nombre, qu’il a fait brûler par Mme Brémond, vigilante exécutrice des impitoyables autodafés qu’il ordonnait.
Il peignait, surplombant ses natures mortes; quelquefois même elles étaient placées sur le sol. Van Gogh a peint aussi très fréquemment de cette façon-là. On obtient ainsi de nouvelles rencontres de plans et des aspects inédits de volumes. C’est la manière toute moderne de peindre des natures mortes opposée à celle des natures mortes d’hier, où les objets sont vus presque toujours en géométral. Mais c’est la manière aussi qui fait dire à tant de gens que les natures mortes de Cézanne sont le plus souvent de guingois. Huysmans lui-même a écrit cette bêtise-là. Alors qu’il est si simple de regarder la nature et de voir que Cézanne a merveilleusement et exactement peint ce que nous pourrions voir nous-mêmes par nos propres yeux, s’ils devenaient enfin clairvoyants. Ce sont encore ici les jeunes peintres qui, dans leur sottise infinie, ont exagéré, dénaturé les vérités picturales révélées par Cézanne; et les amateurs, ignares, naturellement s’en prennent à Cézanne.
Chaque nature morte de Cézanne, quant à la couleur générale, diffère de celle qu’il peignit hier et de celle qu’il peindra demain. On a, chaque fois, pour ses grandes natures mortes au moins, un attrait nouveau. Claude Monet, Pissarro, Renoir se répètent; Cézanne ne se répète jamais. C’est que chaque fois il se donnait la vraie peine de «faire un tableau», tandis que pour Renoir, par exemple, un tableau, ajouté à celui qu’il a peint hier, représente un peu un devoir charmant, une joie sans heurts, sans à coups, qu’il se donne pour le plaisir de joliment réassortir les mêmes tons à des objets continuellement répétés.
Aussi Cézanne, morose, reste-t-il à part, très à part; tandis que Renoir, à tout instant, va rejoindre la compagnie joyeuse des peintres heureux de peindre et de vivre!

LES JOUEURS DE CARTES
(Collection Auguste Pellerin)
Sous l’influence des Musées, des parlottes du café Guerbois—et le Romantisme régnant encore,—Cézanne, avant et aux environs de l’année 1870, peignit un certain nombre de compositions, dont quelques-unes seulement trouvèrent, par la suite, grâce devant lui.
On peut citer parmi ces compositions: Le Jugement de Pâris (1860); Une tentation de Saint Antoine (1870); La Femme à la puce (Tableau aujourd’hui disparu, dit M. Vollard, et qualifié par lui de «pochade drolatique et pseudo réaliste»); Un après-midi à Naples ou le Grog au vin (1863); Scène en plein air (1870); La Promenade (1871); l’Enlèvement (1867); le Festin (1868); La Léda au Cygne (1868); etc.
Rubens et Delacroix étaient alors ses influences les plus directes; mais, toutefois, Cézanne ne témoignait d’aucune servilité envers ces maîtres, si l’on veut bien se souvenir des tableaux que je viens de nommer,—et qui constituèrent à l’époque ce que l’on peut vraiment appeler de «beaux scandales»!
Plus tard, d’ailleurs, Cézanne reviendra à son goût des compositions, puisque l’on peut encore citer: La nouvelle Olympia (1872);—une nouvelle Tentation de Saint Antoine (1873); le Déjeuner sur l’herbe (1878),—La lutte (1885).
Toutefois, il faut bien dire que ce ne sont point là, en général, ses œuvres préférables. Je concède même que les détracteurs de Cézanne peuvent d’abord rayonner quand ils considèrent seulement la photographie du tableau dénommé: Le Triomphe de la Femme.
Ces hommages d’un peintre, d’un évêque mîtré, de joueurs de trompette, etc., à une jeune femme étendue nue en plein centre du tableau, il faut bien répéter, encore une fois, que c’était là, dans l’esprit de Cézanne, non pas un tableau, mais une esquisse amusante, divertissante, qui, bien entendu, s’il s’agissait d’un autre peintre, ne serait pas à grief, mais à triomphe! car la couleur encore ici est précieuse: le corps si nacré de la femme et le bel évêque rouge et or.
La toile intitulée Le Pacha, constitue également une plaisante œuvre de Cézanne. Cette femme nue, en boule (mais encore quel joli incarnat de la chair!), devant un gros monsieur tout noir, barbu et chevelu, qui contemple une négresse agitant une palme, je ne donne point cet ensemble pour une œuvre considérable, pas plus que la toile intitulée: La lettre et celle des Brigands au bord de la mer; mais quel attrait rare et insoupçonné!
L’autopsie déconcerte beaucoup d’admirateurs même de Cézanne. Et pourtant le corps de l’homme étendu est admirable. On a souri un jour devant cette Tentation de Saint Antoine, constituée par une femme nue qu’escortent une ribambelle d’enfants nus. Et pourtant, encore, on remarque dans ces diverses Tentations, une œuvre attachante, celle où le saint est dominé par le Diable. Et, dans une autre œuvre: Le Christ et Madeleine, il y a une très belle mise en scène; et le Christ, qui étend le bras au-dessus de la tête d’un vieillard à genoux, est une superbe figure. Je connais peu de tableaux religieux, dans les Musées, qui soient aussi bien composés et aussi émouvants.
Il faut donc, dans ce chapitre des Compositions proprement dites, se montrer encore équitable. A côté de «pochades» (dit M. Vollard) je dirais, moi, plutôt: à côté de tableaux amusants, peints dans un moment d’expansion joyeuse,—il arrive aux plus sombres d’être soudainement, brutalement déridés—à côté, dis-je, de ces tableaux-là, il faut distinguer ces compositions qui, comme La Lutte, constituent un des plus rares tableaux de l’École française de tous les temps. Et, d’ailleurs, tenons pour certain que Cézanne, lui-même, eût fort bien fait le tri de son œuvre, et détruit beaucoup de toiles qu’il tenait pour peu importantes, la Providence lui accordant seulement les tardives années réservées à ses camarades Monet et Renoir, et pendant lesquelles, comme on ne peut plus que se rabâcher, il convient impérieusement de réserver à la Postérité le seul dessus du panier de son œuvre.
Aussi bien, Cézanne lui-même ne se sentait vraiment apte qu’à comprendre et mettre en action le mot de Courbet: «Il ne faut peindre que ce que l’on voit!» et, sans modèles directs, il était mal à l’aise.
Ses compositions restent donc la moins louable partie de son œuvre. Délassements ou désirs d’imiter Rubens, Delacroix, les grands lamas de la composition historique,—ou même le Giorgione (Giorgione: le Concert champêtre; Cézanne: Scène de plein air), il y a là un effort qui ne se peut comparer à la magnifique réussite que Cézanne atteindra dans ces genres si divers et si également élevés: Le paysage, la nature morte, la Figure et le Portrait.
D’ailleurs, lui-même s’en rendra si bien compte que ses vingt dernières années, il les consacrera uniquement aux quatre genres qui établissent aujourd’hui sa très complète originalité.
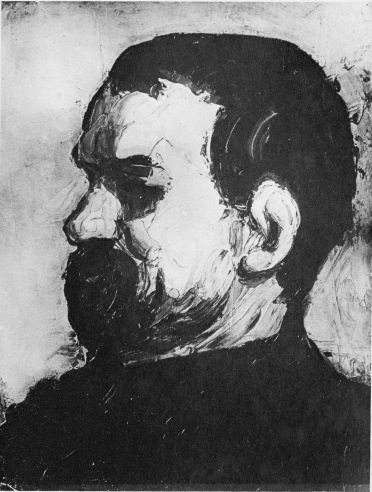
PORTRAIT D’HOMME
(Collection Auguste Pellerin)
PHOTO DRUET
Cézanne fut, à coup sûr, clairvoyant, en dessinant un grand nombre de figures à l’Académie Suisse. Car, plus tard, devenu aussi misogyne que misanthrope, il n’aura aucun goût à faire poser devant lui un modèle masculin ou féminin. Et, enfin, comme je l’ai déjà noté, ce n’est pas lorsqu’il sera retiré définitivement à Aix qu’il pourra appeler dans son atelier un modèle féminin, ce modèle fut-il venu de Marseille. L’hypocrite pudibonderie de l’honnête ville se fût certainement révoltée; et enfin Cézanne lui-même en était arrivé à ne plus pouvoir contempler pendant des heures le charmant animal appelé femme, et qu’il appelait, lui, un veau.
Pour les modèles masculins, les soldats de la garnison d’Aix qui se baignaient fréquemment dans la rivière l’Arc, dès les premiers beaux jours, étaient de suffisantes «indications». Enfin, avec quelques gravures, en reprenant, en changeant des mouvements choisis par d’autres peintres, il pouvait s’en tirer, comme il disait, et peindre petites et grandes toiles de Baigneurs et de Baigneuses.
Ces toiles-là abondent dans son œuvre. Elles sont presque toutes rares parmi les plus rares. Jamais des nus ne furent plus miraculeux dans des paysages plus accordés. Je ne veux pas parler de rythme, de «balancement», d’équilibre, etc.; je ne veux pas employer un argot de peintre; je ne veux certes pas commenter ce qui se sent, ce qui ne s’explique pas; mais, toutefois, s’il vous est donné quelquefois de revoir des Baigneurs ou des Baigneuses de Cézanne, croyez que vous avez là devant vous des tableaux que vous n’oublierez plus jamais, qui vous hanteront si vous êtes capable de sentir la Peinture.
Sans doute, cette singulière, cette exceptionnelle originalité aura dérouté longtemps. Renoir, lui, eût moins de peine à imposer son éternel modèle, toujours le même, et qui, dans la fertile imagination de ce peintre, se tient tantôt debout, tantôt couché ou encore assis. Je conviens que Cézanne est plus rébarbatif, plus dur à comprendre. Parbleu! chaque fois il vous entraîne vers des abîmes de rêverie. Et, enfin, il déforme, comme on dit, intentionnellement? Non pas, je le répète. Ce sont ses disciples, ses plagiaires qui racontent qu’il déforme. Ses déformations, que des cuistres voient si bien, eux qui ne sont pas peintres, ce sont des gestes, des attitudes, des contours vrais pour Cézanne. Il ne voyait pas autrement. Il justifiait le mot de son ancien camarade Zola: «Quand on a la gloire d’apporter quelque chose, cela déforme ce que l’on apprend!» Ensuite, la couleur faisait le reste. Elle accentuait, elle aggravait les formes qui choquent tant les esprits bâtés. Et cela fait, qu’on le voulût ou non, c’était Cézanne qui avait peint un magnifique tableau; il ne demandait plus que de le sentir, sinon de le comprendre.
Ah! les délicieux peintres qui ne dérangent pas les idées reçues!
Avec Cézanne, il n’en va pas de même. Comme tous ses paysages, chaque figure constitue un nouveau tableau, qui n’a vraiment pas son pareil. Je ne pense pas, en effet, que l’on puisse comparer l’Arlequin à la Femme au chapelet, et les Joueurs de Cartes aux Baigneuses. Donc, si l’on possède une figure peinte par Cézanne, et si vraiment on l’admire, on a bientôt le désir féroce de posséder le plus tôt possible d’autres figures de ce peintre. Il est celui-là éternellement convoité. Le connaître un peu, c’est vouloir entrer toujours plus avant dans son œuvre; et, à chaque pas, ce sont de nouvelles surprises, de nouveaux étonnements, de nouvelles sources de joie. Toutes les plus brillantes qualités se sont rencontrées dans ses figures. Elles sont puissantes, gracieuses, étranges et toujours inédites. Restons en contemplation devant elles, elles nous diront très vite pourquoi elles sont extrêmement originales. Oui, je sais, les amateurs sont habitués à une joliesse maniérée, à un poncif qui date de plusieurs siècles; les Musées les éduquent de travers; la Source, de M. Ingres, voilà le sommet de l’Art! et c’est pourquoi ils trouvent laides les figures de Corot, laides les figures de Delacroix; et pourquoi, au Musée du Louvre, ils acceptent qu’on place les Primitifs dans un couloir!
Pourtant, en regardant les figures de Cézanne, quel entraînement de pensées!
Depuis les frères Le Nain, quel peintre a représenté des paysans plus vrais, plus émouvants que les Joueurs de cartes! Tout ici est du premier ordre: les visages comme les vêtements, les fonds comme les accessoires. Il est impossible d’être plus haut. C’est la vie même, sans emphase, sans accent théâtral. Et ce n’est pas réaliste; car tout est surhaussé par le dessin, par la couleur. Sans détails, d’une exécution large et volontaire, ces Joueurs de cartes (ceux par exemple de la collection Auguste Pellerin) égalent la plus belle œuvre qui soit au Monde! C’est un émouvant hommage à ceux de la glèbe, qui gardent tout en jouant aux cartes—un jeu pour roi fou!—la gravité de ceux qui labourent, qui moissonnent en silence, en peinant, en suant tant qu’ils peuvent, tandis que pour eux les oiseaux chantent, concert du ciel accordé à ces taciturnes, dont la langue ne se délie que sous les rasades du vin!

LA VIEILLE FEMME AU CHAPELET
PHOTO DRUET
Par ses Baigneurs et ses Baigneuses, Cézanne a créé aussi d’exceptionnels Edens, où les arbres croissent en frondaisons épaisses, où les corps en liberté se délassent dans de rares accords de gestes et de poses. Et c’est là une autre remarquable partie de l’œuvre de Cézanne. Cherchez bien: il n’y a, dans toute la Peinture française, que Delacroix qui ait une originalité de formes et de couleur aussi vivante, aussi personnelle, aussi frénétique. Tout ici a été inventé par Cézanne. Il a été quelquefois «enfantin», a noté Mirbeau lui-même! Soit! il ne pouvait en être autrement. Aucune règle, aucune tradition, aucune béquille d’aucune sorte pour soutenir Cézanne. C’est un homme qui ose tout, sans cesse; qui se trompe, parfois, peut-être! mais qui marque toujours chacune de ses figures d’un accent impérissable. Et toujours ses figures sont à lui, bien à lui, entièrement à lui. Voyez, au contraire, les manifestations du poncif chez Degas, chez Manet, chez Fantin-Latour, chez Puvis de Chavannes, etc., etc. Ses figures, surtout, n’ont point cet air avantageux et glorieux exprimé par tant de peintres dans des décors purement de convention. Elles participent de la vie humble et sans gloire des choses naturelles. Elles sont calmes, silencieuses, et ne comptent ni plus ni moins que les arbres du champ, que les déclivités du sol. Elles s’équilibrent toutefois, harmonieusement, avec tout ce qui vit autour d’elles. Voilà la source de leur beauté et de leur bonheur.
S’il s’agit d’une figure seule, cette figure prend allure d’un être synthétique. Elle prend forme d’élément, au même titre que l’air, l’eau, le feu. Elle est l’élément humain parmi les autres éléments. Donc, que l’on ne s’attende pas à une pose et à un geste photographiques. Pas davantage ne sera exprimé un parfait modèle anatomique. Ce sera l’homme représenté en dehors de tout modèle convenu. Ni héros grec ni pauvre hère creusé par la misère. Un homme moyen, voilà tout, qui ne sera que la vie pensante du paysage. Il sera nu et Cézanne l’appellera Baigneur, pour expliquer sa nudité devant la mer ou sous des arbres dressés en colonnes de temple. Pas d’anecdote; et petits ou grands tableaux n’affirmeront rien que ceci: peindre des nus dans de merveilleux paysages qui se feront tendres, délicats et nuancés, pour servir de fonds à des corps également fragiles et amoureusement peints.
Et quelle simplicité de sujets! Comme ils seraient vite insupportables entre les mains d’un autre! Si l’on ne demande pas à Cézanne d’être un grand peintre d’histoire, à la manière de Véronèse ou de Delacroix; si, simplement, on ne s’attarde qu’aux spectacles qu’il nous montre, sans chercher plus qu’il nous offre, on est bien contraint de convenir que dans les sujets qui ont été les siens, il est allé jusqu’au fond de l’expression et du caractère; on est forcé d’avouer qu’il a dégagé de choses humbles, terrestres, strictement humaines, des accents jusqu’alors inouïs, tout à fait inédits; et cela, tout cela vaut bien que l’on réserve dans l’histoire de la Peinture française une large place à Cézanne, une place entre Delacroix (ce grand tourmenté, qui a préféré, lui aussi l’expression aux règles figées de l’Académisme) et Gustave Courbet, qui, lui, tenant du Réalisme, n’en a pas moins gardé un persistant amour du Romantisme et un métier encore tout nourri de ce que l’on appelait alors, si puérilement, les «meilleures façons de peindre.»
Les gens exigeants qui demandent à un peintre de peindre l’âme de son modèle, ont tout lieu d’être satisfaits des portraits peints par Cézanne; car si jamais un peintre entreprit de débusquer derrière les yeux d’un individu ses excellentes ou médiocres pensées, ce fut bien Cézanne. Nul comme lui ne fora dans la bouffissure ou dans la carcasse d’un visage. Cent séances ce n’était pas de trop pour arriver à exprimer tous les stigmates qu’une peu secourable existence inflige à chacun de nous. Aussi, nous sommes encore ici très loin des solennels et traditionnels portraits des dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième siècles, époques qui devaient garantir aux portraiturés de la noblesse, de l’élégance, du style, enfin, pour tout dire; même si la vulgarité se caractérisait incontestablement dans tous les plans du visage.
Le grand nombre de séances nécessaires à Cézanne pour peindre un portrait, limita naturellement le nombre et le choix de ses modèles. C’est pourquoi il peignit si souvent son propre portrait, celui de sa femme et les visages des humbles, des fermiers ou des vieilles femmes qui étaient à son service.
Alors, il pouvait être exigeant—et faire de chaque séance de pose une manière de supplice, dont le renouvellement, chaque jour suivant impérieusement le précédent, devait vous consterner d’épouvante.

PORTRAIT DE MADAME CÉZANNE
PHOTO DRUET
M. Vollard raconte dans son livre si varié comment il posa, lui, plus d’une centaine de séances. Ce chapitre entier consacré à l’histoire de son portrait est singulièrement vivant; et il éclaire d’une façon sans pareille le genre de vie de Cézanne, ses exigences, ses colères; tout ce qu’il était en un mot et comment il se comportait pendant tout le temps qu’il «piochait» un portrait. Il fallait être quasi muet, ne jamais le contrarier, approuver tous ses propos, ne pas hasarder surtout une opinion qui, bénigne en soi, devenait tout à coup orageuse dès qu’elle passait à travers le cerveau de Cézanne. M. Gustave Geffroy—il lui consacra plus de quatre-vingts séances—l’agaça fortement en lui parlant toujours de son protecteur, M. Georges Clemenceau, duquel il attendait sa nomination au poste d’administrateur de la Manufacture des Gobelins. Cézanne lâcha un beau jour le portrait, et ne le termina point. C’est cet unique portrait qui figure aujourd’hui dans la collection Pellerin, et dont M. Geffroy se sépara pour une somme alléchante—se «vendant ainsi lui-même!», selon le mot de M. Ingres.
M. Choquet qui mourut laissant dans sa collection plus de trente tableaux de Cézanne, fut, à coup sûr, un modèle plus accompli pour Cézanne; car il existe de ce clairvoyant amateur plusieurs portraits dus au maître d’Aix.
Mme Cézanne posa, ai-je dit, maintes fois. Le choix est malaisé entre toutes ces effigies. Elles sont toutes singulièrement originales et attirantes. Si jamais l’âme a été peinte, je le répète, ce fut assurément toutes ces fois-là. Il est probable que, durant la pose, Mme Cézanne ne bronchait pas, ne se permettait aucune réflexion, restait sage et inerte, répondait en un mot à toutes les exigences que Cézanne réclamait implacablement. Aussi, considérez attentivement tous ces portraits; et demandez-vous s’ils ne sont pas autrement vivants, autrement éloquents, autrement originaux que les portraits de M. Ingres, à coup sûr «contournés» par une science têtue, mais terriblement pareils les uns aux autres, Cézanne s’appuyant sur la vie et M. Ingres sur les Musées.
Certes, des gaucheries, des maladresses se révèlent encore parfois, ou du moins ce que nous, très compétents, assurément, nous appelons ainsi. Nous voulons toujours que les portraiturés soient de nobles hommes, de divines femmes. L’Apollon du Belvédère ou la Vénus de Milo, pas de milieu. Mais nous n’avons donc jamais regardé notre prochain, dont le visage est presque toujours apparenté à celui d’un animal inférieur? Nous n’avons donc jamais remarqué les déformations, les stigmates, les hideurs dont nous écrase la vie? Y a-t-il tant que cela «deux yeux pareils», des oreilles «délicatement ourlées» et des bouches «voluptueusement dessinées»? Mais voyez combien il y a peu de gens que vous embrasseriez sans vous cuirasser d’héroïsme, sans excuse de parenté! Or, chez M. Ingres, qui travaillait dans le poncif, tous les visages sont aimables, plaisants, sinon attirants.
Evidemment, je ne vois pas Cézanne peintre de portraits mondains. On ne sort pas «beau» de ses mains. C’est un terrible juge d’instruction qui ne redoute pas de vous déplaire et même de vous décourager. Il a peint des visages comme des pommes, sans plus de flatterie. Mieux même: pour exprimer tout le caractère, il a exagéré des tares, inventorié toutes les rides, tous les plis; et l’on n’était jamais quitte avec lui, ce qu’il n’avait pas trouvé aujourd’hui, il le trouvait le lendemain; et consciencieusement il notait toutes ses trouvailles, s’encolérant seulement quand il ne trouvait rien, et qu’il partait pour un portrait faible et vain. Alors, bientôt il lâchait tout et crevait sa toile.
Le public, qui chérit sa propre image, ne pouvait donc s’adresser à Cézanne; et c’est pourquoi la diversité de ses portraits est si peu étendue. Cette autre précieuse raison: amour frénétique et touchant de chacun pour soi-même, devait obliger Cézanne,—comme je l’ai déjà, pour une autre raison, noté plus haut—, devait obliger encore Cézanne à s’adresser à lui-même, à sa femme, à quelques admirateurs bien rares du moment, et à ces humbles qui se soucient fort peu d’une beauté conventionnelle. Aussi, comme pour Corot, ce sont—avec les figures—les portraits peints par Cézanne qui déroutent le plus les amateurs. Pourtant, c’est là, bien entendu, la partie la plus attachante, la plus singulière de son œuvre.
Ses portraits sont rébarbatifs, grognons,—peints à sa propre image. Ils n’ont pas, certes, cet air avantageux, immodeste, des portraits ordinaires et extraordinaires. Et que Dieu en soit loué! Car l’impudeur des portraits est, en général, une chose affligeante. Poser devant un peintre et ensuite laisser parader son effigie, cela est un aveu de stupide orgueil qui effare les âmes les plus molles. Avec Cézanne, l’aventure est moins dangereuse. On ne peut, vraiment, portraituré par lui, être qualifié de matamore ou de bellâtre. Et alors, il vous est possible de placer au mur le portrait que vous accorda Cézanne. Du reste, il recueillera bientôt, ce portrait, tellement de sottises, louanges et railleries mêlées, qu’on l’enlèvera peut-être pour ne plus le conserver que sous nos yeux, dans l’intimité d’une chambre de repos ou de travail. Les portraits peints par Cézanne sont des compagnons sûrs au royaume du silence.
Ah! la gravité mystérieuse, bougonne, du Portrait de Mme Cézanne,—à la pincette (Collection A. Pellerin)! Ce portrait où la robe rouge chaudron épouse avec tant d’émotion la tenture verdâtre et le fauteuil d’un jaune assourdi! Quel portrait en dehors de toute peinture, d’une réalisation jusqu’alors inédite, où rien n’est sacrifié au désir de plaire, où tout acquiert une singulière force de volonté et d’humilité! Le peintre, cette fois, a tremblé devant la nature. Il s’est contenté d’être patient, méditatif et foncièrement docile.
Des gens louent Cézanne paysagiste, Cézanne peintre de natures mortes, et se rebiffent dès qu’on veut leur imposer des Baigneuses ou un de ses portraits. Il faudra encore des années de patients rabâchages pour arriver à situer Cézanne tel qu’il le mérite. Le principal, c’est qu’un groupe d’individus soit déjà arrivé à l’estime de ses paysages et de ses natures mortes. Comprend-il ces œuvres-là davantage? Non, certes! mais enfin elle a la douce manie de croire qu’elle peut comprendre quelque chose, cette Ame de la Bourgeoisie, cette «Brute hyperboréenne des anciens jours, cet éternel Esquimau porte-lunettes, ou plutôt porte-écailles, que toutes les visions de Damas, tous les tonnerres et les éclairs ne sauraient éclairer!» (Baudelaire, Curiosités esthétiques). Et, si un jour, Cézanne devait passagèrement tomber même dans l’oubli, quitte à reparaître deux cents ans plus tard dans une lumière nouvelle d’apothéose, eh bien! nous persisterions, nous, à croire—qu’avons-nous besoin d’approbation?—que Cézanne est haut parmi les plus hauts, et que tous les livres et commentaires du Monde sont d’ailleurs bien impuissants à exprimer son apport pictural, son génie, en un mot, pour tout dire!
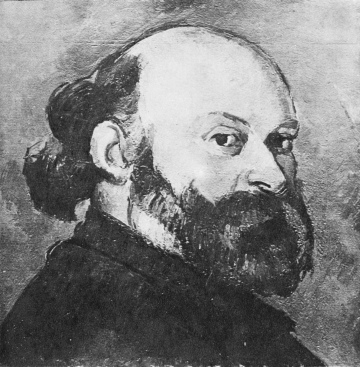
PORTRAIT DE CEZANNE
par lui-même
PHOTO DRUET
Théodore Duret.—Les Peintres impressionnistes. (Floury, éditeur. Paris, 1906.)
Emile Bernard.—Souvenirs sur Paul Cézanne (Messein éditeur. Paris, 1912).
Octave Mirbeau et Théodore Duret.—Cézanne (Bernheim-jeune, éditeurs. Paris, 1914).
Ambroise Vollard.—Paul Cézanne (Ambroise Vollard, éditeur. Paris, 1915).

PORTRAIT DE MADAME CEZANNE
(Collection Auguste Pellerin)
PHOTO DRUET
| Pages | ||
| 1 | Paul Cézanne (photographie) | titre |
| 2 | Louis-Auguste Cézanne (Photographie) | 1 |
| 3 | Le Jas de Bouffan (Façade sur le jardin) | 17 |
| 4 | Le Jas de Bouffan (La Serre) | 33 |
| 5 | L’ancien atelier de Cézanne (Campagne d’Aix) | 49 |
| 6 | La Villa au bord de l’eau | 64 |
| 7 | Le grand arbre | 80 |
| 8 | Maisons au tournant d’un chemin | 97 |
| 9 | L’Estaque | 112 |
| 10 | Les poires et le sucrier blanc | 128 |
| 11 | Le Pacha | 144 |
| 12 | La tentation de Saint Antoine | 160 |
| 13 | Baigneurs | 176 |
| 14 | Baigneuses | 192 |
| 15 | Les Joueurs de cartes | 210 |
| 16 | Portrait d’homme | 216 |
| 17 | La vieille femme au chapelet | 224 |
| 18 | Portrait de Madame Cézanne | 232 |
| 19 | Portrait de Cézanne par lui-même | 240 |
| 20 | Portrait de Madame Cézanne,—à la pincette | 248 |
| Pages | |||
| I. | — | Le Milieu | 1 |
| II. | — | Cézanne à Paris et les Influences | 27 |
| III. | — | Cézanne à Auvers | 47 |
| IV. | — | Cézanne et le public | 73 |
| Premières expositions | 73 | ||
| Marseille | 95 | ||
| L’Estaque | 95 | ||
| VI. | — | Cézanne et ses contemporains | 105 |
| VII. | — | Cézanne se retire définitivement à Aix | 119 |
| VIII. | — | Sa fin et sa gloire posthume | 147 |
| IX. | — | La technique de Cézanne | 163 |
| X. | — | Ses paysages | 181 |
| XI. | — | Ses natures mortes | 195 |
| XII. | — | Ses compositions | 209 |
| XIII. | — | Ses figures | 217 |
| XIV. | — | Ses portraits | 229 |
| Appendice | 241 | ||
DIJON.—IMPRIMERIE DARANTIERE.
| Erreurs corrigées: |
| né le 19 Janvier 1839=> né le 19 janvier 1839 {pg 16} |
| réclama par d’enthousiates lettres=> réclama par d’enthousiastes lettres {pg 22} |
| daus le désordre=> dans le désordre {pg 42} |
| vieille paonnne=> vieille paonnne {pg53} |
| raffinement=> raffinenement {pg 81} |
| En cette ocurrence=> En cette occurrence {pg 90} |
| le spectable=> le spectacle {pg 124} |
| ce dévoiment=> ce dévoiement {pg 162} |
| origiginaux=> originaux {pg 166} |
| Pissaro=> Pissarro {5 x} => |